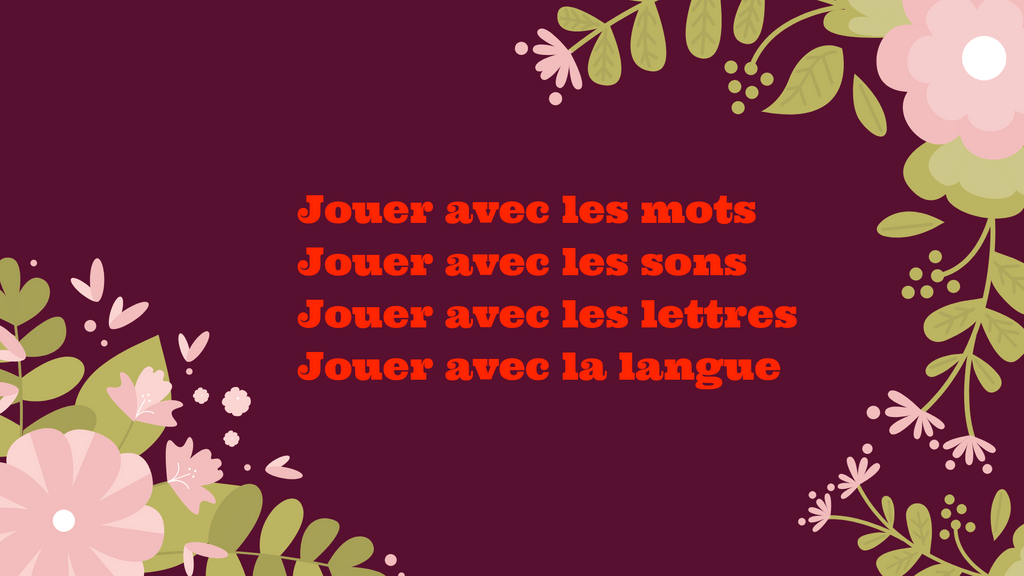Ce fut un régal sans nom de lire vos textes en avant première. J’en ai eu l’eau à la bouche avec toutes ces expressions plus gourmandes les unes que les autres pour cette proposition d’écriture N° 158!
Voici vos textes. Je vous en souhaite une belle lecture.
D’Isabelle
Le panier à salade
Le flic le cuisinait depuis des heures. Le type était haut comme trois pommes, il avait des yeux de merlan frit et la coupe au bol. Il semblait avoir le cerveau en marmelade. Ce plan, c’était de la daube, fallait être bête à bouffer du foin ! Sans doute qu’il avait voulu se faire une retraite aux petits oignons avant de sucrer les fraises et d’aller manger les pissenlits par la racine ? Ou simplement, voulait-il mettre du beurre dans les épinards ? Un plan vite fait sur le gaz avec plein de biffons en rang d’oignon !
Tout ça pour des prunes. Il avait dû prendre le melon et se rouler lui-même dans la farine pour imaginer un truc pareil. Il s’est retrouvé en carafe et hop dans le panier à salade !
Non, ce type n’était vraiment pas le couteau le plus aiguisé du tiroir… Le beurre, l’argent du beurre… A la banque, ils n’y étaient pas allés avec le dos de la cuillère sur la sécurité, les coffres étaient surveillés comme le lait sur le feu. Les carottes étaient cuites d’avance !
Le type n’avait pas la frite et pédalait dans la choucroute, il racontait des salades. Le flic, quelque peu soupe au lait, n’avait pas l’intention d’avaler des couleuvres. Il savait qu’il avait du pain sur la planche et avait bien essayé de refiler la patate chaude. Dans le comico, les prévenus étaient serrés comme des sardines, chacun traînant ses casseroles sans en faire tout un fromage. Avec ce type, ce ne serait pas de la tarte mais les collègues avaient tous un sanglier sur le feu et ne pouvaient être au four et au moulin. Le type faisait mine de tomber dans les pommes et servait la soupe à la grimace. Le flic mettait les pieds dans le plat et était décidé à en faire de la chair à pâté, à le hacher menu sans crainte des Bœufs-Carottes car il était expérimenté. N’est-ce pas dans les vieux pots qu’on fait les bonnes soupes ? Ce type n’était tout de même pas en sucre !
Mijoté à petit feu, en deux coups de cuillère à pot, le type avait avoué. Finalement, c’était passé crème. Le flic, satisfait, se leva et partit s’en mettre plein le gosier.
Après avoir mangé comme des gorets, son ami demanda au flic :
-Alors ? Il est passé à table ?
-Je lui ai mis la rate au court-bouillon, répondit le flic, tout baigne dans l’huile !
Et ils taillèrent la bavette encore un bon moment.
De Claudine
Le repas du dimanche, c’est tout un rituel orchestré par ma grand-mère Yvonne, un vrai cordon bleu. Qui sait mettre les petits plats dans les grands. Surtout en ce qui concerne les victuailles. L’étalage des plats que nous avons déjà eu le plaisir de voir, nous a mis l’eau à la bouche. Nous les grands enfants, nous profitons de ces instants d’avant ; d’avant l’arrivée des grands. Après, rien ne sera pareil. Il nous faudra boire le calice jusqu’à la lie. Car pas question de quitter la table au moins jusqu’au dessert, pour éviter de déclencher une vraie tempête dans un verre d’eau ; croyez-moi, ce n’est pas de la tarte de devoir supporter ces oncles et tantes qui n’ont pas inventer le fil à couper le beurre.
L’aîné, l’oncle Hubert, celui qui a le plus de bouteille. Dès qu’il nous voit, il dit toujours : « je ne vais pas te manger, voyons ». Il pédale dans la semoule ce pauvre tonton. C’est certain, ce n’est pas lui qui va casser trois pattes à un canard.
Sa femme, la tante Jeanne s’est fait rouler dans la farine lorsqu’elle l’a épousé, mais bon, avec lui, elle a de quoi mettre du beurre dans les épinards. Elle compte pour du beurre, mais pour vivre comme un coq en pâte, que n’accepterait-elle pas ?
Le second, l’oncle Edmond, à chaque phrase prononcée par les autres, il ajoute son grain de sel. Celui-là aussi, il demande le beurre et l’argent du beurre. Pour un rien, il met les pieds dans le plat. De quoi rester comme deux ronds de flan tellement il est de mauvaise foi.
Hubert, lui, balance, chaque dimanche, la même phrase qui ne veut rien dire : ce n’est pas la fin des haricots :
-Qu’est-ce que tu crois, que nous allons pleurer comme des madeleines parce que pour une fois tu es le dindon de la farce ? Avec ta manie de nous faire avaler des couleuvres, tu vas nous faire croire que tu ne fais pas d’omelette sans casser des œufs ! On ne va pas en faire un fromage de tes petits soucis. D’accord, chacun doit gagner sa croûte. Mais tant que tu n’en es pas à sucrer les fraises, il y a de l’espoir.
-C’est un peu fort de café, lui répond Edmond, tu ne te prends pas pour de la petite bière et je te rappelle que l’on ne dit jamais « fontaine je ne boirais pas de ton eau ». Tu as les yeux plus gros que le ventre ; regarde-toi, tu as la tête comme un melon.
-Va te faire cuire un œuf, tu vas faire chou blanc avec ta mauvaise foi.
Dans la famille, il y a un phénomène.
La Arlette, qui doit avoir une écrevisse dans le vol au vent, c’est une grande asperge qui a une vraie langue de vipère, alors autant dire qu’en entendant ses beaux-frères se casser du sucre sur le dos, elle boit du petit lait. Elle a toujours une dent contre quelqu’un. Si elle ne trouve personne à cuisiner, elle n’est pas dans son assiette. C’est dans ces moments-là qu’il faut marcher sur des œufs et se faire oublier. Quelle mauvaise langue cette Arlette.
Mes parents, comme d’habitude, sont absents du cercle formé par leurs sœurs et beaux-frères ; ce n’est pas leur tasse de thé ces conversations oiseuses. Ma mère devient rouge comme une tomate dès qu’elle est mal à l’aise. Elle préfère s’isoler pour déguster les mots d’un bon livre.
Heureusement, il y a des tantines super sympas ; Huguette est marrante avec sa coupe au bol. Haute comme trois pommes, elle met les bouchées double dans tout ce qu’elle entreprend. Et elle en a du pain sur la planche. Ce n’est pas elle qui racontera des salades ; actuellement, elle est dans le pétrin, elle n’a plus un radis, mais pas question de se mettre la rate au cours bouillon. Elle a mangé son pain blanc ; elle est dans sa période de vache maigre. Elle a simplement oublié qu’il ne fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
J’ai des cousines adorables ; Emma et sa peau de pêche, douce comme un brugnon. C’est une crème, elle croque la vie à pleine dents ; jamais la moindre phrase douce-amère, ou aigre douce. Toujours prête à mettre la main à la pâte.
Stella, c’est une étoile, belle à croquer ; chacun la dévore des yeux. Elle écoute, toujours prête à couper la poire en deux pour faire la paix. Elle ne fait jamais la fine bouche et dit à chacun de s’occuper de ses oignons. En douceur.
Arlette la titille souvent en lui disant mi-figue mi-raisin.
-Dis donc ma belle, tu n’as pas l’impression d’être la nouille de service, la bonne poire.
Stella en a gros sur la patate mais elle ne mange pas de ce pain-là. Elle a la gorge nouée, elle n’en fera pourtant pas un fromage et dit pour couper court aux mots discourtois :
-J’ai une faim de loup.
Sa sœur arrive, Ludivine, et dit à l’assemblée : « j’ai appuyé sur le champignon pour être à l’heure ». J’ai l’estomac dans les talons et je suis prête à me faire péter la sous ventrière, et à danser devant le buffet ; je crois que je vais tomber dans les pommes, dit-elle en riant. Quelle surprise, elle qui a un appétit d’oiseau.
Grand père, avec ses magnifiques cheveux poivre et sel, intervient à cet instant ; en écoutant ses gendres et sa fille Arlette, la moutarde lui est montée au nez. Pendant un temps, il a avalé sa langue, ne voulant pas mettre de l’huile sur le feu mais de la cuisine, près de grand ma’, il veillait au grain. Il laissait ces têtes de lard pédaler dans la choucroute. Comme chaque dimanche, il a la tête farcie par ces deux cornichons. Il sait que Edmond a un verre dans le nez. Avec ces dents longues, il y a de quoi lui claquer le beignet. Quant à l’autre, qui a un œil au beurre noir, résultat de sa propension à tenir la dragée haute à un quidam, il faut toujours qu’il donne du grain à moudre par sa bêtise. Pas question qu’ils mettent l’un et l’autre de l’eau dans leur vin. Ils viennent là pour faire bombance, comme des mouches sur un pot de confiture.
-Franchement, Yvonne donne de la confiture à des cochons, murmure grand pa’. Mais bon, quand le vin est tiré il faut le boire.
Nous voyons enfin apparaître ma charmante sœur. Tout heureuse, nous percevons qu’elle a des choses à dire.
-Devinez quoi ? Pas de réponse. Vous donnez votre langue au chat ?
Arlette, toujours prompte à parler, ne ramène pas sa fraise. Bizarre.
-Alors Arlette, pas un mot, toi si soupe au lait quand tu n’as pas l’info en premier. Non, non, je ne veux pas faire monter la mayonnaise.
Gilles et moi venons d’emménager ; nous allons pendre la crémaillère dans quinze jours. Et cerise sur le gâteau…un bout d’chou va arriver dans six mois.
Chacun en reste baba. Elle n’a pas la langue dans sa poche et connaît bien tout ce beau monde. Elle a besoin d’aide. On ne prend pas les mouches avec du vinaigre, doit-elle penser.
-Vous êtes tous conviés ; nous serons un peu serrés, comme des sardines, mais ce sera à la bonne franquette ; à la fortune du pot, comme on dit. Hé oui, les carottes sont cuites et vous passez dans une autre catégorie, grands oncles. Je pense que chacun va mettre de l’eau dans son vin et que personne n’aura l’idée de tirer les marrons du feu ?
A ces mots, chacun se lève et dit en chœur : nous allons sabler le champagne. Tous tenant à se partager le gâteau, c’est la cohue vers la cuisine. Quoi de mieux que de faire bonne chère pour rabibocher tout le monde. C’est du gâteau, cette bonne nouvelle
De Sylvie
Aujourd’hui, c’est le premier dimanche du mois de mars, c’est le jour auquel je me rends à la maison de retraite « Les Pinsons » pour aller voir Grand Papa. J’aimerais le voir plus souvent, mais il ne me faut pas moins de deux heures de route en voiture pour y aller, alors une fois par mois, je pars la journée pour passer le plus de temps qu’il m’est possible avec lui. Grand Papa était chef renommé dans un grand restaurant à Avignon, c’est lui qui m’a donné l’amour de la cuisine. La première fois qu’il m’a laissée mettre les mains dans la farine, j’étais haute comme trois pommes, pourtant je m’en souviens comme si c’était hier, je n’étais pas peu fière qu’il m’initie à son art. Depuis, j’en ai fait mon métier. Je travaille comme second de cuisine au restaurant étoilé « La table d’Élise » à Aubagne. Je projette d’ouvrir mon propre restaurant dans deux ou trois ans environ. Le temps d’avoir un apport financier suffisant et assez de bouteille pour me lancer. Pendant les trajets qui m’emmènent vers Grand Papa, je me remémore chaque fois les repas que je prenais chez eux et ces pensées me mettent inévitablement l’eau à la bouche. C’est Grand Maman qui cuisinait au quotidien, mais lorsqu’il y avait des invités, famille ou amis, c’est Grand Papa qui se mettait aux fourneaux. Il n’aurait cédé sa place pour rien au monde. Ils étaient beaux tous les deux, Grand Maman était douce, souriante, des traits fins et un joli visage avec un teint de pêche. Grand Papa, comme au restaurant, déformation professionnelle oblige, menait son petit monde à la baguette, et avec lui on ne devait pas manger son beurre avant son pain. La nourriture était sacrée et on se devait de la respecter. Il m’a appris la rigueur, la valeur du travail, la patience, il me disait souvent que je ne devais pas vouloir le beurre, l’argent du beurre et la crémière, chaque chose en son temps, d’abord le travail, l’exigence, les sacrifices, ensuite viendra la récompense.
Toujours est-il que nous ne faisions qu’une bouchée de tout ce qu’il nous servait tant ses plats étaient succulents, nous les dévorions d’abord des yeux, puis nous nous délections de toutes ces saveurs, plus délicieuses les unes que les autres. Et je recevais en guise d’encouragements, des compliments des convives parce que j’avais mis la main à la pâte. Grand Papa m’adressait un clin d’œil complice et si petite soit ma contribution, je jubilais intérieurement parce que l’humilité était de rigueur avec Grand Papa. Quelques fois, lors des vacances scolaires, je passais plusieurs jours chez eux, j’étais la plus heureuse, j’étais comme un coq en pâte. Je cuisinais avec Grand Maman, j’aimais ces moments partagés, je n’ai pas oublié la bonne odeur des tartes fumantes que nous confectionnions lorsqu’elles sortaient du four. Mes goûters étaient aussi bons que beaux. Bien qu’elle n’en n’eût pas fait son métier, Grand Maman aimait la bonne chère et elle était un véritable cordon bleu. J’arrivai enfin aux Pinsons, j’avais quitté La Ciotat sous un soleil radieux et à Lédignan était mi-figue mi-raisin. Mais peu m’importait la couleur du ciel, j’étais tout excitée et impatiente de voir Grand-Papa. Lorsque je le rejoignais, j’apportais le panier repas et nous mangions en tête à tête les mets que j’avais préparés, à la bonne franquette. Le directeur des Pinsons me laissait m’installer dans la cuisine le temps de dresser et réchauffer nos assiettes. Grand Papa était heureux de partager ces repas avec moi. Il me parlait de Grand Maman, à quel point elle lui manquait, et moi je lui parlais de mes dernières créations culinaires, de mes projets. Il continuait à me prodiguer ses conseils et je buvais ses paroles. Il me disait que j’étais la relève, qu’il avait un devoir de transmission et qu’il poursuivrait ses enseignements tant qu’il le pourrait. Il ne m’a jamais dit qu’il était fier de moi mais je savais qu’il l’était, il y a des regards qui se passent de mots. Lorsqu’en grandissant il me laissait préparer le repas pendant le temps que je passais chez eux, même si je faisais chou blanc, il n’a jamais eu de paroles dures. Il était exigeant, jamais cassant ni humiliant. Il me disait qu’il fallait s’entraîner encore et encore pour devenir une excellente cuisinière. Il était autoritaire, un peu soupe au lait, mais Il était juste et apprécié par sa brigade au restaurant. Cela me fait mal au cœur de le voir ainsi, lui qui était si dynamique, perdre de plus en plus son autonomie, et constater que sa mémoire récente s’efface à une vitesse vertigineuse. Heureusement, sa mémoire ancienne est quasiment intacte et nous pouvons parler de notre passion commune. La journée touche à sa fin et c’est toujours un déchirement de le quitter, mais avec la promesse d’une prochaine journée, je pars le cœur moins lourd. Les beaux jours arrivent et nous pourrons, lors de nos retrouvailles le mois prochain et si le temps est clément, piqueniquer dans le parc des Pinsons, sous l’olivier centenaire.
De Saxof
L’ENVOL
Maurice est né après la guerre en avril 1947. Il pouvait tenir dans une coquille de noix. Sa mère en avait gros sur la patate de ce petit bout haut comme trois pommes. Mais, cette femme était une crème et veillait au grain pour son petit.
Quand il est rentré à l’école, il avait très peu grandi, alors, ce n’était pas de la tarte, car tous les élèves de sa classe pouvaient lui manger la soupe sur la tête. Il comptait pour du beurre et ne savait jamais si les blagues à son encontre était du lard ou du cochon ! Difficile pour lui, surtout quand il se prenait un marron, ou une patate et rentrait le nez éclaté.
A l’adolescence, il traînait beaucoup de casseroles, et ne supportait pas qu’on dise de lui qu’il n’avait pas inventé le fil à couper le beurre. Il avait tellement mangé la grenouille qu’il s’est mis à casser du sucre sur le dos de ses détracteurs.
Plus tard, il décida de ne plus jamais faire de tempête dans un verre d’eau, même s’il était souvent pris pour le dindon de la farce. Son but ultime était de devenir la crème de la société, faire régulièrement bombance et sabler le champagne. Il s’accrocha à ses études qui avaient commencé mi-figue mi-raisin et il refusait de pédaler dans la semoule préférant s’imaginait comme un coq en pâte.
Vers 30 ans, il n’avait fait qu’une bouchée de sa situation, il avait fait son beurre. PDG d’une boite numérique, il avait du pain sur la planche, il mettait les pieds dans le plat lors de débats, et demandait à ses collaborateurs de mettre les bouchées doubles. Il racontait des salades pour obtenir son dû. Parfois la moutarde lui montait au nez. Dans l’ensemble, il n’aimait pas en faire un fromage, et souvent à la fin les réunions, l’équipe se fendait la poire. Il ne cherchait pas à avoir le melon, ni avoir systématiquement raison, mais ne supportait pas de se faire rouler dans la farine.
Sa réponse quand ça ne lui convenait pas était « c’est du flan ». C’était un patron, bon comme du pain, et certains vendredis soirs se terminaient pour tous, à la bonne franquette et à la fortune du pot, que certains qualifieraient d’auberge espagnole.
Son emploi et son physique ne lui ont pas permis d’être un coeur d’artichaut, et il était toujours dans les choux, célibataire, il n’avait jamais trempé son biscuit. Il aimait la bonne chère et cerise sur le gâteau, c’était un fin cordon bleu.
Un matin, il est tombé dans les pommes, ne se sentant pas dans son assiette depuis deux jours. Il faisait peu de sport et préférait appuyer sur le champignon sur les circuits automobiles. Etait-ce la fin des haricots ? Allait-il, bientôt, manger les pissenlits par la racine? Finalement, il resta comme deux ronds de flan quand le médecin lui dit qu’il devait commencer par perdre sa brioche et réduire les excès culinaires.
Lui le bon vivant, à la fourchette alerte, aimait dire « un dessert sans fromage c’est comme une belle à qui il manque un œil ». Et pourtant désormais pour garder la frite, il devra boire de l’eau entre la poire et le fromage……léger, le fromage.
Si sa boite était bonne comme la romaine, côté santé, il avait fait chou blanc, mais pas au point, malgré son fort caractère, de devenir soupe au lait. Il pensait déjà aux prochaines ripailles avec la pendaison de sa crémaillère, il n’avait pas réussi à gagner tant de blé pour se priver. En quittant l’hôpital, il avait la banane.
De Zouhair
Ces expressions culinaires tellement imagées m’ont toujours intrigué. Alors, j’ai décidé d’en découvrir l’origine.
Par exemple, « Ne pas être dans son assiette » a été inventée par un pilote d’avion dont l’appareil penchait à droite.
-Tu n’es pas dans ton assiette ! criait-il au copilote qu’il avait imprudemment laissé piloter l’avion pendant qu’il était aux wc. Depuis, le copilote ne se sentait pas dans son assiette chaque fois qu’on lui faisait un reproche.
Être « roulé dans la farine » vient, elle, d’une vieille tradition celte où l’on faisait rouler les enfants dans la farine pour que la récolte de blé de l’année suivante soit bonne. Pourtant, ces enfants ne se sont jamais sentis manipulés ou trahis pour autant !
Quant à « Avoir un bœuf sur la langue », elle a été inventée par un président de la République qui adorait visiter la foire agricole. Non seulement il aimait « caresser le cul des vaches » comme il se plaisait lui-même à le dire mais, ce que tout le monde ne sait pas, car il le faisait discrètement, il léchait les vaches et notamment les bœufs. Toutefois, l’expression n’était pas appropriée pour ce président car il finissait toujours par dévoiler les secrets qu’on lui avait confiés !
L’expression « Un cordon bleu » nous vient du haut Moyen-Age. Elle est un peu cruelle. Les seigneurs avaient pour fâcheuse habitude de pendre les mauvais cuisiniers. La corde pour les pendre était rouge, comme le sang. Le cordon bleu, au contraire, rappelait le sang noble et permettait de distinguer les meilleurs cuisiniers du château. On le leur mettait autour du cou lors d’une cérémonie organisée tous les ans par les châtelains.
Dans le même ordre d’idée, « pendre la crémaillère » vient du fait que le dernier élément placé dans un nouveau logis était une tige en fer suspendue dans la cheminée à laquelle on suspendait la marmite pour la cuisson des aliments. Mais, des passionnés d’automobiles se la sont appropriée. Elle désigne chez eux la liaison entre le volant et les roues. Lorsqu’ils disent que quelqu’un a pendu sa crémaillère, cela veut dire que l’automobile est rentrée dans un arbre et que la crémaillère est restée suspendue.
Pour « Faire chou blanc », on pourrait penser que dans un champ où l’on ne cultive que des choux rouges, lorsque l’on tombe sur un chou blanc, c’est un événement ! On rameute alors tous les cueilleurs pour le leur montrer et le soir on fait une grande fête célébrant le chou blanc. Bien sûr, on danse sur le rythme de « Savez-vous planter les choux, à la mode, à la mode …Savez-vous planter les choux, à la mode de chez nous » !
Mais ce n’est pas du tout cela.
En réalité, si un Berrichon vous dit « Je vais te donner un bon chou » !, cela veut dire « Je vais te donner un bon coup » ! Depuis le XVIIIème siècle, un « chou » est un « coup ». Comme le jeu de quille était très apprécié à cette époque, lorsqu’on ne faisait tomber aucune quille, on disait qu’on avait « fait chou blanc ».
L’expression suivante, par contre, m’a donné du fil à retordre. Ce n’est qu’après de longues recherches que je compris son origine. Les ronds de flan, comme chacun sait, sont des éléments qui ont une apparence solide et ferme mais qui, en fait, ont une structure liquide qui oscille, se dodeline et s’étale en une bouillie infâme si l’on a le malheur de trop pencher l’assiette sur laquelle ils reposent paisiblement. Par conséquent, « rester comme deux ronds de flan » signifie que l’on se trouve dans un équilibre instable, prêt à se rompre, si l’on nous secoue un peu trop.
La science m’est venue en aide pour l’expression « mi-figue, mi-raisin ». Grâce au progrès des croisements génétiques, des scientifiques ont réussi à créer un fruit gros comme une figue mais dont la chair est liquide et pleine de pépins.
De Catherine M
Une journée qui commence mal
Las !
Je ne suis vraiment pas dans mon assiette ce matin. Pas encore remise de ma réunion d’hier. Tous ces cravatés qui savent tout sur tout et pour qui je ne compte que pour du beurre. Insupportable. Sans compter ceux qui scrutent le cadran de leur montre, à peine discrets, attendant l’heure de lever le camp pour faire bonne chère à la meilleure table du coin. Tels de vieux coqs en pâte. Faire bombance, sabler le champagne, millésimé s’il vous plaît, et être servis par le fin cordon-bleu régional. Pitoyable !
Mais pourquoi n’ai-je pas refusé d’assister à cette mascarade ? Je me suis encore fait rouler dans la farine. Y avait-il un dindon dans la farce au menu ? Oui, moi. Et aujourd’hui voilà le résultat. Crevée, écœurée, au propre comme au figuré. « Au bout de ma vie », comme dirait ma fille. Et cerise sur le gâteau, ce jour, visite du BB, le Big Boss, vous savez, celui qui sourit tous les 30 février …
Ceci dit, il y a au moins deux ans, j’ai aperçu une mini fossette se creuser dans sa joue droite. J’en étais restée comme deux ronds de flan ! Impossible de savoir si c’était du lard ou du cochon.
Bon, nous sommes mercredi. Encore trois jours à tenir avant la pendaison de crémaillère de ma meilleure amie. Ouf ! Chez Sophie, comme toujours, deux mots d’ordre « à la bonne franquette » et « à la fortune du pot ». Pas de chichi, pas de tralala. « Venez comme vous êtes » comme dit la pub de qui vous savez.
Surtout pas de cravates, ce serait la fin des haricots …
De Francis
Entre la poire et le fromage
Tu as eu les yeux plus gros que le ventre.
J’ai souvent entendu maman employer cette expression lorsque nous étions enfants. C’était la guerre, nous n’avions pas grand-chose à manger, mais ce n‘était pas la fin des haricots à la maison, il n’y avait pas de quoi mettre du beurre dans les épinards, c’était comme ça. Faire bonne chère est une expression que nous ignorions. Bien souvent nous mangions à la fortune du pot, à la bonne franquette. Pas de quoi en faire un fromage, mes parents étaient là pour veiller au grain.
« Nous avions un cochon, Adolphe, que nous nourrissions tous les deux jours, grâce aux restes de la cantine du camp des Américains. Sa viande était ainsi bien entrelardée, une couche de graisse, une couche de maigre, une couche de graisse, une couche de maigre. (Je plaisante) »
Ma mère partait au ravitaillement dans les fermes des environs. Elle avait du pain sur la planche. Mais, elle n’était pas du genre à pleurer comme une madeleine. Elle ne comptait pas pour du beurre. Elle était un peu soupe au lait et ne se laissait pas rouler dans la farine. Elle cuisinait les fermières aux petits oignons, les pressait comme des citrons jusqu’à ce qu’elles consentent à lui céder quelques œufs et un morceau de beurre. Parfois, il était aussi gros qu’une noisette, un peu plus quand même. Si elle faisait chou blanc, elle évitait de mettre de l’huile sur le feu mais il ne fallait pas lui raconter de salades, lui courir sur le haricot. Elle n’avait pas un bœuf sur la langue. Elle ne supportait pas d’être le dindon de la farce, cerise sur le gâteau si la moutarde lui montait au nez entre ses dents, elle leur disait d’aller se faire cuire un œuf.
Puis, nous avons petit à petit repris le cours normal des choses. Nous ne vivions pas comme des coqs en pâte mais quand même. Maman n’a pas changé, elle n’est pas devenue bonne comme la romaine. Elle nous a fait connaître ses qualités de cordon bleu. Nous avions l’eau à la bouche lorsque nous approchions de la cuisine. Passés à table, nous ne faisions qu’une bouchée de ses plats. Il n’était plus question de manger sur le pouce ni du bout des dents, personne ne ramenait sa fraise.
Les temps ont passé, nous n’avons pas été tous les jours dans notre assiette, nous avons pris de la bouteille, de la brioche, parfois cassé du sucre sur le dos de connaissances en parlant de leur physique. Nous avons mangé la grenouille en attendant de manger les pissenlits par la racine. Mais en attendant, faisons un petit repas dans le Nord en commençant par une bonne tranche de cramique avec un bol de café chicorée. Le midi, nous avons le choix entre les moules frites, la fricadelle, le beultekaze, le potjelesch, la carbonade flamande suivie d’un maroille odorant et crémeux et pour finir un quartier de tarte au libouli.
Vous allez penser que c’est fort de café, pourtant il n’y a pas de quoi rester comme deux ronds de flan.
Sablons le champagne. A votre santé !
De Françoise B
Ma très chère Agathe,
J’ai tant de plaisir à t’écrire que je voudrais le faire tous les jours, si ce n’est la crainte de te lasser qui me retient toujours de te submerger de lettres. Mais, la quantité de nouvelles à te communiquer me doit de le faire aujourd’hui.
J’ai rencontré Huguette, accompagnée de sa dernière-née, une enfant magnifique déjà haute comme trois pommes et une peau de pêche qui en dit long sur sa beauté future. Elle, elle ne change pas, les grossesses n’ont pas de prise sur son physique. Elle a la chance d’être toujours plate comme une planche à pain et maigre comme un haricot vert. Son aîné tient d’elle, on dirait une asperge. A maintenant vingt ans, il peut lui manger la soupe sur la tête.
Cette femme est une crème, elle a toujours la pêche et sa famille, c’est sa vie. Même si avec les enfants elle a du pain sur la planche, elle ne manque jamais de traiter son mari aux petits oignons, et lui dans son foyer, ma chère, vit comme un coq en pâte. Huguette est un vrai cordon bleu et si ça continue, bientôt son mari aura de la brioche ! Il faut dire qu’il le lui rend bien. Il cherche toujours plus de travail qui leur permet de mettre un peu plus de beurre dans les épinards.
On en était à discuter le bout de gras depuis un moment quand Lucette est venue vers nous. C’était évident, elle avait besoin de parler. Elle nous a raconté la triste histoire de sa fille. Violette, un vrai cœur d’artichaut que sa mère surveillait pourtant comme le lait sur le feu, s’est finalement mariée avec un petit gars quelconque, venu de nulle part. Il l’a sûrement séduite à lui raconter des salades dans le creux de l’oreille, au bal du samedi soir. Et elle – à croire qu’elle a un pois chiche dans la tête- elle a dit oui à tout. L’opinion et les mises en garde de sa mère ont compté pour du beurre.
Ils sont partis et se sont mariés à la sauvette. C’est fou ! Mais au retour, il fallait bien vivre. Pas question de faire des petits boulots, c’était pour lui comme travailler pour des prunes. Alors, il a accumulé les combines jusqu’au jour où il s’est fait prendre les doigts dans le pot de confiture.
Je te laisse imaginer la suite, police, garde à vue, interrogatoire. Il s’est mis à table. Et il en a beaucoup dit. Lucette nous a confié qu’il était vraiment dans la panade ; la note sera salée, parait-il.
Pour sa fille, c’est la fin des haricots ! Pauvrette, elle a fini de manger son pain blanc ; dindon de la farce, elle se retrouve au pain sec et à l’eau. Une vie rêvée partie en eau de boudin. Malheureuse ! Quand on est une trop bonne poire, on se fait facilement rouler dans la farine. Malgré tout, cette mésaventure connaîtra peut-être une fin heureuse. Lucette a réussi à décrocher pour sa fille un poste d’assistance auprès du comité du festival de cinéma fantastique. Certes, un emploi saisonnier. C’est un début. Lucette espère que sa fille saura en tirer les marrons du feu, et surtout vivre avec un bœuf sur la langue. Son travail ne commencera que dans quelques mois. La construction de la nouvelle salle de spectacle est toujours en cours. Le résultat est prometteur. Une grande surface avec des sièges bien espacés. Histoire de ne pas se retrouver assis, serrés comme des sardines.
Voilà pour l’essentiel. Il me semble t’avoir tout dit aujourd’hui.
Ah oui ! Des nouvelles de notre club de marche. Le rythme des sorties a augmenté. J’ai toujours la frite mais j’avoue avoir maintenant du mal à suivre. A la fin de la dernière randonnée, on s’est fait prendre par le brouillard, une véritable purée de pois à couper au couteau. Si nous ne nous sommes pas perdus c’est bien grâce à Hugo. J’ai fini les pieds en compote.
A la joie de te lire. Milles pensées affectueuses.
Claude
De Roselyne
Chez Cordon Bleu
Cordon Bleu revient de ses emplettes. Il s’apprête à se mettre aux fourneaux pour faire bonne chère avec ses amis, copains comme cochons. Mais, ils ne paraissent pas dans leur assiette. Ils sont mi-figue, mi-raisin, on dirait que le torchon brûle. Allez, venez-vous taper la cloche ? Aujourd’hui, je pends la crémaillère. Même, si j’ai mis les petits plats dans les grands, c’est à la bonne franquette.
Hé, arrêtez de vous chamailler et de pleurer comme des madeleines. Que vous arrive-t-il ? Nous étions en train de prendre un café au bar du village où nous avons rencontré le vantard du coin, qui sans emphase nous a appris que nous nous étions fait rouler dans la farine. Par qui ! Mais jamais tu le croiras … par Jeannette. Non ! La fille de Bernuchon. Oui, elle-même. Nous voulions lui acheter un bout de terrain pour y planter des arbres fruitiers, des pêchers pour avoir une jolie peau de pêche. Mais, voilà elle l’a promis à quelque d’autre. Bien sûr, cela ne nous a pas plu d’être les dindons de la farce. Nous avons mis les pieds dans le plat et la discussion a tourné au vinaigre. Nous avons essayé de couper la poire en deux, mais elle est têtue comme un âne. Nous avons fait chou blanc, pas su veiller au grain. L’autre a tiré les marrons du feu et nous, nous faisons la soupe à la grimace.
Bon enfin, ce n’est pas la fin des haricots. Cordon Bleu, nous allons sabler le champagne pour ta pendaison de crémaillère. Chez toi, nous sommes comme des coqs en pâte, jamais de prise de bec. Tenez les amis, aujourd’hui tête de veau, je l’ai faite sauce gribiche, régalez-vous. Bacchus a ouvert grand les tonneaux, à flot coulera le nectar de ses vignes.
Allez, ne restez pas là comme deux ronds de flan ? Buvons, ripaillons et ne pensons à rien d’autre, viendra le moment entre la poire et le fromage où nous serons repus, que nos ventres seront distendus par la nourriture et nos visages rougis par le bon vin, ensemble nous pourrons refaire le monde et nous assoupir en souriant à l’avenir.
Chez Cordon Bleu, la vie est belle,
La chère est bonne, déborde la coupe,
Chez Cordon Bleu, la vie est belle,
Le vin coule, bonne est la soupe,
Chez Cordon Bleu, la vie est belle,
Les belles filles chaloupent,
Chez Cordon Bleu, la vie est belle
Jamais, jamais d’entourloupe
De Pierre
Au milieu des années quarante, en pleine guerre et occupation Allemande, un village perdu dans le centre de la France, proche de la ligne de démarcation.
La quiétude y régnait et rien ne laissait présager les évènements qui surviendraient bientôt.
Au bout du village, il y avait un château occupé par une famille de petite noblesse ; il était doté d’un domaine agricole très prospère. La famille De Savignac, occupante du domaine, était composée en premier lieu du patriarche, Honoré, un vieillard nonagénaire (c’était rare à cette époque), qui se faisait appeler l’empereur car il avait connu Napoléon III, le nabot. Ses ancêtres, il le rappelait souvent, furent raccourcis durant la Terreur. Sourd comme une taupe, il collait en permanence son oreille droite sur le poste de radio familial afin de capter les nouvelles. Il y avait ensuite Alphonse, le fils de l’empereur et sa femme Blandine, une fieffée « salope », selon les termes du vieillard et qui n’attendait que le vieux « casse sa pipe » pour prendre possession de tous ses biens.
Alphonse, gros travailleur, gérait le domaine agricole avec deux journaliers. Il était de santé précaire, ayant contracté les fièvres en Indochine. D’apparence un peu « demeuré », il savait à peine que le pays était en guerre et qu’il fallait nourrir ceux ou celles qui venaient acheter fruits, légumes, ou animaux vivants de la ferme et il y en avait à foison. Blandine, bien en chair malgré ses quarante-cinq ans, l’œil pétillant, était au contraire vivace d’esprit et gérait à merveille les finances familiales en évitant de mettre tous ses œufs dans le même panier et en faisant payer aux clients de passage bien plus que le prix fort, c’était la guerre et le marché noir fonctionnait à plein. Il y avait aussi Marc, leur fils, qui avait fait des études et qui vivait à Paris. Il travaillait dans la presse, c’était dur en ces temps d’occupation et de censure imposée.
-Alors pépé, quelles sont les nouvelles du jour ? demande-t-elle à l’empereur en lui criant dans mes oreilles ?
-Pas bonnes Blandine, répond le vieux qui avait encore toutes ses facultés et qui savait raisonner ; pas bonnes dit-il, toujours cette « saloperie » de guerre et pendant que certains se gavent, baignent dans le lard beaucoup d’autres crèvent de faim. Enfin, de toute façon, vu mon grand âge, mes carottes sont cuites et je n’en verrai pas le bout de cette guerre et vous, vous profiterez de l’héritage, dit-il mi-figue mi-raisin.
-Mais non pépé on vous aime, on vous souhaite d’aller jusqu’à cent ans ou plus, vous êtes encore valide. Regardez votre fils avec sa gueule de merlan frit, il ne finira pas comme vous, il ne vous va pas à la cheville !
-Alors, pourquoi l’as-tu épousée, par intérêt je pense ?
-C’est lui qui est venu me chercher, rappelez-vous.
-C’est vrai, il n’était pas très hardi avec les filles et tu l’as bien dessalée ma salope, dit-il !
-Et vous pépé, vous en avez un peu profité avec moi aussi, dit-elle en le regardant droit dans les yeux, sourire moqueur.
La porte d’entrée sonna. C’était Maurice, le maire qui venait prendre de leurs nouvelles. Il était ami de la famille. Sur le plan physique, gras comme un moine, ce qui semblait incongru en ces temps de disette !
-Alors Honoré comment vas-tu ?
-Très bien ; que nous vaut ta visite ?
-Les Allemands vont passer te voir mais attention à vos deux journaliers, il faut qu’ils s’en aillent, ils sont en situation irrégulière et devraient être au STO.
-Pas question, je les héberge, ils sont précieux, travaillent très bien et Alphonse a besoin d’eux. J’expliquerai aux Allemands.
-Tu espères les rouler dans la farine ; tu te trompes et tu risques gros.
-A mon âge pas grand-chose ; qu’ils me fusillent, dit l’empereur… de plus, les Allemands ont besoin de nous pour se ravitailler, ils apprécient les produits de notre terroir.
-Allons Honoré, je ne veux pas être le dindon de la farce et mettre en péril le village. Il faut que tes deux protégés partent…
Une fois le maire sorti, l’empereur demanda à Blandine d’aller prévenir les deux garçons dont l’un s’appelant Igor, de parents Ukrainiens et l’autre Robert. Blandine les connaissait bien et les appréciait pour leur travail et pour autre chose, c’est dans les vieux pots que l’on fait de la bonne soupe, leur disait-elle à tous les deux. Celui qu’elle préférait, c’était Igor avec sa tête d’angelot.
-Les amis, leur dit-elle, il faut partir, les Allemands vous recherchent, des gros ennuis en perspective. Un ami fermier peut vous conduire à la ligne de démarcation, il connaît tous les chemins possibles pour y arriver.
-D’accord Blandine, répond Igor avec son accent slave mais sans vous, sans toi, on ne peut rien faire. Moi étant communiste, recherché par la Gestapo, ma tête est mise à prix et Robert qui a fait de la taule est recherché pour le STO …
-Mes amis, dit-elle, désolée, faites vos valises, le temps presse ; vous quittez les lieux ce soir avant que tout ne parte en sucette pour vous comme pour nous ; je préviens Alphonse. Je vous donnerai un peu d’argent pour subvenir à vos besoins pendant quelques jours.
Un peu plus tard, une voiture allemande s’arrête devant la grille d’’entrée il en sort l’Obertleutnant Gustav Steiner, un bel homme relativement jeune, officier de la Wehrmacht qui stationnait à une dizaine de kilomètres de là. Il connaissait la maison pour y être déjà venu prendre fruits et légumes. Il parlait un français impeccable, ayant séjourné deux ans en France comme étudiant.
-Bonjour monsieur le comte, dit-il à l’empereur, je vois que vous avez bonne mine.
-Parlez plus fort, dit le vieillard, je ne vous entends pas, expliquez-nous votre visite.
-Voilà, dit Gustav Steiner, vous n’êtes pas sans savoir que votre maison est proche de la ligne de démarcation. De plus, votre domaine est le plus grand de la région ; nous allons nous y installer quelques temps. Rassurez-vous, on ne prendra pas beaucoup place. De plus, nous ne serons que trois ; nous y installerons une petite antenne radio et resterons très discrets.
Blandine entre dans la pièce et salue le militaire, qui lui fait en retour un beau sourire :
-Que nous vaut cette visite ? demande-t-elle. L’empereur lui explique la situation, mais comme elle s’adapte vite, elle s’adresse à l’officier et lui dit :
-Venez monsieur l’officier, je vais vous montrer les lieux.
Les deux journaliers prirent à leur corps défendant la poudre d’escampette. Ils étaient en fait trois, Alphonse décidant de se joindre à eux car il avait soif d’aventure, loin du carcan familial et il en avait marre de compter en permanence pour du « beurre ». Deux jours plus tard, la police allemande ramena Alphonse qui s’était fait prendre aux mailles du filet en tentant de franchir la ligne. Le lieutenant Gustav Steiner se porta garant pour lui, mais quant aux deux autres, ils étaient entre de bonnes mains, dans les locaux de la Kommandantur et il était clair que leurs carottes étaient cuites.
Les mois qui suivirent furent calmes, sans évènement notable, hormis la santé de l’empereur qui déclina. Il n’était plus dans son assiette. Il mourut à la fin de l’automne et eut droit à des obsèques dignes de son rang. Il partit manger des pissenlits par la racine et rejoindre ses illustrent ancêtres. Les Allemands quittèrent le domaine, la ligne de démarcation était franchie. La situation du conflit prenant un tournant nouveau, tout semblait partir en sucette pour l’occupant.
Année 1944, libération du territoire. Blandine ne revit pas son fils assassiné par les SS pour acte terroriste et elle-même arrêtée et interrogée par le FFI :
-Alors Blandine De Savignac, comment allez-vous ? lui demande l’officier français d’un ton sardonique. Vous savez que votre situation est peu reluisante et j’en énumère les chefs d’accusation : intelligence avec l’ennemi, relations intimes avec les Allemands, il est vrai que vous aviez la « cuisse légère » si on en croit les témoignages et aussi trafic, marché noir. C’est lourd et vous risquez gros.
-Je ne suis pas responsable de l’hébergement des Allemands au domaine. Quant au marché noir, tout le monde en faisait par ici. Il n’y a pas de quoi en faire un fromage !!
Blandine fut incarcérée en attendant son procès qui serait sans doute expéditif, l’époque n’était pas aux « nuances ». Avec la complicité d’un garde, elle avala du poison et mourut dans d’atroces souffrances. Le fils, Alphonse, se retrouva seul à gérer le domaine et grâce à une amie d’enfance retrouvée qui accepta de le seconder, il put assurer à nouveau son exploitation.
Cette chronique s’achève là : elle témoigne d’une époque qui fut pour certains, marques de bravoure et de résilience, pour d’autres, bassesse et soumission et pour la grande majorité des gens, l’objectif principal était de trouver à manger ; on était loin d’une vie de coq en pâte…
De Lisa
D’après Laurence, la langue regorge d’expressions riches et variées. Il faut parler de notre patrimoine culinaire. C’est parti !
On va essayer de comprendre. Tiens ! Le premier de la liste est :
« Ne pas être dans son assiette » qui signifie « ne pas se sentir bien ».
Si je pige bien ! La définition est d’une personne qui ne se sent pas bien. Entre nous, il ne faut pas se plaindre en public car on peut se confier qu’avec des vrais amis, qui se comptent sur le bout de nos doigts.
On continue et je vois qu’elle marque « Compter pour du beurre » qui veut dire « Ne pas avoir d’importance », comme la semaine dernière, un pote a organisé son anniversaire. A table, un copain lui dit « je compte pour du beurre et je tiens à souligner que de parler de politique est dangereux dans un gueuleton car on peut donner une opinion sur une personne et voter son adversaire le jour des élections. »
Je vous rassure que je ne vais pas faire toute la liste car sinon demain je suis encore là.
Alors ! « Faire bonne chère » Que veut dire ce charabia ?! D’après le dico, on a un bon repas. Il faut dire que l’on se régale avec ses expressions sans parler de nourriture…
Allez ! Encore deux ou trois au passage ! « Être comme un coq en pâte ». Attends avant d’aller dans le dico, je vais essayer de deviner, je dirai un poulet en croûte, et pourquoi pas ?
Alors la définition est d’avoir une vie confortable. A part, entre nous et vu les journaux, personne n’est à l’abri d’un malheur.
Patience ! Le dernier pour le plaisir. Alors ! « A la bonne franquette” qui est tiré de “franc” d’origine normande et picarde (franquette qui signifiait “en toute franchise”) « en toute simplicité ». On dirait mes personnages dans les propositions et…
Tout ça me donne faim !
D’Elie
Mardi 14 mars 2023.
Les derniers hommages au centenaire.
L’année 1995, la jeune fille Yèyinou perdit son père, un centenaire, pendant qu’elle était en classe de terminale. Le départ inattendu de son père par le chemin de toute la terre fait que l’oncle Raphaël n’était plus dans son assiette, y compris les autres membres de la famille. Cependant, c’est par surprise que sa nièce, Yèyinou réussit à son examen du baccalauréat pour la session de juin 1995. Depuis ce moment, l’oncle devrait bien ressasser les douleurs du décès de son frère, Constant, et penser aux diverses charges laissées par le défunt. Il faut reconnaître que la circonstance du temps et les tempêtes qui soufflent sur l’oncle Raphaël et les siens se réfèrent à la fortune du pot. Mais devant les difficultés de la vie, bien des émotions nécessitent d’être comptées pour du beurre, afin de faire face aux défis qui déjà jalonnent le chemin.
Les funérailles de notre centenaire s’étiraient vers la fin. Pourtant, les amis, les parents et alliés du défunt ne cessaient de venir apporter à la famille leurs soutiens matériels et financiers. Et pour qui sait apprécier, il saute à l’œil nu que ces invités vivaient comme des coqs en pâte. Cette remarque ne pourrait ni faire l’objet d’aucun appel au bon sens et d’instruction particulière.
Et comme à l’accoutumée, les étrangers, qui franchissent les portes de la maison, méritent une attention particulière de leur hôtes. Monsieur Raphaël tenait à bien recevoir tous ceux qui avaient voyagé de loin pour l’assister dans les funérailles de son frère défunt. Un de ses neveux, Jacques, fut envoyé pour chercher les serviteurs déjà disposés pour les réceptions. Il leur fit appel d’un ton aimable et courtois :
-A vous mes chers bien-aimés, servantes, avec les amis cordons bleus qui avez toujours accompli votre mission dans de telles circonstances, veuillez-vous approcher de nos invités pour le service.
Dans les costumes en tissus rouge brillantiné, les cordons bleus et les serviteurs ont démarré leur service avec tous les soins, le tact et la charité qui sont dus aux personnalités de grande distinction. Dans de pareilles circonstances, il est facile que les moments solennels et ceux de nature sacrée virent à la discorde ou à l’anarchie.
Par conséquent, les cordons bleus ont aussi instruit les serviteurs à veiller au grain sur le service afin de ne causer ni aucune frustration et dommage aux autorités et les hommes du peuple venus pour la circonstance.
L’inhumation du centenaire, Constant, était bien loin d’être l’occasion de répandre d’abondantes et amères larmes mais une opportunité d’actions de grâces à Dieu pour les œuvres accomplies durant les périodes de son existence. C’est un géant homme qui avait marqué son siècle par tant d’œuvres politiques louables, et qui a construit de ses propres fonds des écoles, des hôpitaux et des places publiques pour l’épanouissement et l’éducation de la jeunesse ascendante dans la commune.
Le souhait de l’oncle Pascal était de ne jamais faire chou blanc à l‘occasion de l’inhumation de l’illustre, au point de perdre la face devant les amis qui l’avaient tant soutenu. Nos illustres invités ont en réalité sablé le champagne selon les goûts et bien à la volonté. L’inhumation du centenaire, Constant, était prise à la crémaillère et les repas et les champagnes étaient pris à la bonne franquette.
Pendant que l’on célébrait le rappel à Dieu de l’Illustre Constant, Yèyinou la benjamine, qui venait de réussir son diplôme du baccalauréat, était blottie dans la bergerie du verger qui était non loin de la maison. Elle y versait d’abondantes et amères larmes et poussaient de grands cris stridents qui traversaient l’espace des ondes. Les oncles et les tantes accoururent en direction et constataient que la jeune fille Yèyinou était éperdument dépassée par le départ de son père et se roulait dans le sable. Elle devint inconsolable et gémissait. Sa tante Paulette, une experte en psychologie, réussit enfin à l’amener dans l’apaisement. Elle lui dit :
-Pourquoi tous ces cris et pourquoi cet état mi-figue et mi-raisin que tu présentes à la face de ce monde qui est venu nous honorer le jour de l’inhumation de ton père, qui nous a quitté à l’âge mûr ?
Sa petite tante Françoise, qui la croyait brave, restait comme deux ronds de flan à voir les derniers comportements de sa sœur Yèyinou. La tante Françoise, une jeune dame svelte et claire, portait trois cicatrices verticales sur chacune de ses deux joues. Elle a trouvé très peu courageuse sa nièce et apprit de bonnes leçons à son sujet. Pour l‘avoir, cette dernière la roula dans la farine de ses paroles gracieuses. Yèyinou se dépêcha pour se doucher discrètement, puis s’habilla. Elle avait à nouveau intégré les convives pour le service.
En dépit de la faiblesse épidermique que Yèyinou affichait à la face du monde de leurs convives, elle avait un bœuf sur la langue car toutes ses sœurs et frères reconnaissaient qu’elle était la confidente et chérie de son père, le défunt.
Dans un rassemblement comme celui-ci, il n’est pas rare que des brebis galeuses s’infiltrent pour faire des opérations honteuses. Pendant que nous étions dans la maison mortuaire, un gayman a roulé son voisin dans la farine par ses paroles mensongères, puis réussit à lui soutirer la somme de deux millions de francs. La victime cria au secours, mais le larron disparut sans qu’aucune main ne le saisisse. Elle était devenue le dindon de la farce lors des derniers hommages au centenaire, Constant, qui a quitté de ce monde.
C’était la fin des haricots en rapport à ce braquage pacifique. Les évènements peuvent surgir à l‘inattention des hommes qui sont soit unis par le sang ou par un quelconque lien en relation aux hommes. Ils peuvent cacher d’autres réalités plus ou moins cruelles. Mais le triomphe sur toutes ces situations réside dans la force de l’unité et la cohésion. Mais elles tiennent mieux, grâce à la fidélité, aux principes de l’amour dont les chaînons traversent les intempéries de tous les temps.
D’Aline
Je dirais que dans ma famille, tout le monde a un bœuf sur la langue.
Mes tantes, mes oncles… et ils sont nombreux. Ma mère avait sept frères et sœurs. Mon père deux frères et une sœur. Imaginez le nombre de cousins et de cousines que je peux avoir.
Une smala ! Quant à mes parents et ma sœur, ils veillaient au grain ! Je ne comprenais pas bien pourquoi.
Toutes les occasions de sabler le champagne étaient prétextes à mettre du beurre dans les épinards : les mariages où toujours nous faisions bonne chère, ceux qui pendaient la crémaillère à la bonne franquette et même les repas d’obsèques autour du défunt, alors que personne n’était dans son assiette, nous étions souvent tous réunis.
Maman était un véritable cordon bleu, très souvent demandée pour s’assurer de ne pas faire chou blanc. Mon père lui, comme toujours, vivait comme un coq en pâte en regardant maman éplucher, fouetter, râper, pastisser et courir dans tous les sens. Ma sœur, qui avait 10 ans de plus que moi, était mi-figue mi-raisin à chacune de ces festivités. Elle redoutait qu’on lui demande de mettre la main à la pâte.
Devant ces amoncellements de nourriture et le menu annoncé qui me semblait interminable, je restais plantée là, comme deux ronds de flans, à regarder toute cette agitation.
Je savais déjà que je serai le dindon de la farce parce que dans notre région, quand j’étais petite, chaque repas de fête commençait par un bouillon aux perles du Japon, dont le nom me faisait rêver. En réalité, ce n’était que du tapioca et je détestais le tapioca. Beurk ! Ma deuxième hantise, pour ne pas dire écœurement, était la macédoine de légumes à la mayonnaise qui généralement suivait le bouillon. Beurk, beurk, beurk, la mayonnaise. Elle me donnait envie de vomir. Ils sont malins les adultes : ils trouvent des jolis noms, pour me faire avaler n’importe quoi et me rouler dans la farine. J’avais vraiment l’impression de compter pour du beurre : personne, même pas maman, ne s’inquiétait de savoir si j’allais manger ou pas. J’en restais chocolat. De toute façon, il paraît que j’en faisais voir de toutes les couleurs à mes parents. Non, ce n’est pas que je faisais la fine bouche : j’étais anorexique. Ils avaient l’habitude que je ne veuille pas manger. J’étais haute comme trois pommes et me faire avaler quoi que ce soit, il paraît que ce n’était pas de la tarte.
Bon, au milieu de tous ces gens qui riaient, mangeaient et ne buvaient pas que de l’eau, moi, j’attendais les desserts. Je vais pouvoir m’en donner à cœur joie et fondre comme du beurre au soleil. Un mariage ? Forcément une pièce montée et ses choux à la crème avec du caramel ! Là, je ne resterai pas en carafe ! C’était une pendaison de crémaillère ? Avec le champagne, quelqu’un aura prévu des macarons. Mmm ! j’en ai déjà l’eau à la bouche. C’est sûr, une de mes tantes, dont c’est la spécialité, apportera un fondant au chocolat. Au dessert, je mettrai les bouchées doubles. Je patientais, c’était long. Ils n’arrêtaient pas de s’empiffrer.
Oui mais un jour, mon grand-père maternel était mort, nous sommes allés tous ensemble à l’église, puis au cimetière. Une catastrophe. Je ne le connaissais pas beaucoup, mais quand même j’ai pleuré parce que maman pleurait. Puis, tout le monde s’est retrouvé dans la cour de la ferme chez un de mes oncles, autour d’une grande table.
Le repas a commencé comme à l’accoutumée : les perles du Japon, la macédoine à la mayonnaise et puis je ne sais plus trop quoi parce que ça ne m’intéressait pas.
Vous avez compris ce que j’attendais impatiemment en rêvassant.
Tout à coup, des cris m’ont font sursauter !
Ma tante, celle qui n’avait pas inventé le fil à couper le beurre comme disait papa, a mis les pieds dans le plat. C’était la femme de mon oncle. Elle s’adressait à mes parents, en regardant surtout maman. Elle hurlait : « maintenant que ton père n’est plus là, vous allez enfin cracher les casseroles que nous vous traînez tous les deux ? »
Ça tournait au vinaigre.
Maman pleurait et ne pouvait pas parler. Elle baissait la tête comme si elle avait honte ou peur. Papa a dit : « tu n’y vas pas avec le dos de la cuillère ! Là, tu vas trop loin ! Maintenant, tu prends tes affaires et tu t’en vas. Tu ne fais plus partie de la famille. On peut dire que tu as bien choisi le jour. Quelle langue de vipère ! Tu penses à la petite ? Tu crois qu’elle a besoin de savoir ça ? Elle est déjà assez difficile. »
Je n’avais jamais vu papa aussi en colère. Il était tout rouge. Tout le monde s’est tourné vers moi. Mais de quoi ils parlent ? Des casseroles, quelles casseroles ? C’est de moi qu’ils parlent ?
Je ne comprends rien. C’était une tempête dans un verre d’eau ! Rien de grave.
Le dessert ! Le dessert !
Ils se sont tous levés de table, comme si on leur avait coupé l’appétit. Plus personne n’avait envie de rire. Maman est partie pleurer dans une chambre, accompagnée par mon oncle.
Mon père, avec des grands gestes, chassait la langue de vipère.
Ma sœur pleurait. Par petits groupes, ils sont allés se promener. Il paraît qu’ils avaient besoin de digérer Nous n’avons pas mangé de dessert.
C’était la fin des haricots !
De Nicole
Pendre la crémaillère au château
Aujourd’hui, pendaison de crémaillère chez les Dupont de Richepin.
Deux cents invités s’égaillent dans le nouveau parc du château inauguré ce jour. Les serveurs et serveuses veillent au grain, tables dressées, argenterie de sortie. Pour commencer les festivités, plateaux de flûtes de cristal pour sabrer le champagne.
Christian de Richepin fils vit comme un coq en pâte chez ses parents fortunés. Sa préférence pour les jolies femmes presse d’un peu trop près Lucie de Morialmé, qui mi-figue mi-raisin, l’envoie sur les roses. Il en reste comme deux ronds de flanc. Pour lui qui se croit irrésistible c’est la fin des haricots pour son ego.
Alors pour oublier sa déconvenue, il boit plus que de raison, se goinfre de mets délicieux.
Mais sa mère, Caroline de Richepin veille, de crainte d’un scandale dont Christian est friand.
Délicatement mais fermement, elle le conduit dans sa chambre. Lucie de Morialmé en soupire d’aise, dans la fratrie, elle choisit Ludovic. Elle intriguera pour se placer sur sa route amoureuse. La fête suivante sera un grand mariage…
De Catherine G
Mes chers compatriotes,
Oui, la situation est grave, mais point n’est besoin de vous mettre la rate au court-bouillon. Oui, je vous le concède, pendant quelque temps, nous allons faire vache maigre, mais enfin, ce n’est pas la fin des haricots… pas encore en tous cas. Certes, les finances de l’Etat sont au plus mal, à cause des malversations du ministre en charge de l’économie qui nous a bien roulé dans la farine. Je fais mon mea-culpa : j’ai misé sur le mauvais cheval et j’aurai dû veiller au grain. Mais je refuse d’être le dindon de la farce. Je vous conjure de me garder votre confiance et ensemble nous gagnerons. Ma parole ne compte jamais pour du beurre, vous me connaissez bien maintenant. Certes, nous ne ferons pas chou gras demain ni après-demain, car nous avons vous et moi conscience que nous ne pouvons plus vivre comme des coqs en pâte comme nous avions coutume de faire … enfin surtout moi. Ça va nous bousculer un peu, mais nous sortirons grandis de cette épreuve. J’ai besoin de vous et vous avez besoin de moi, alors rencontrons-nous et posons carte sur table… autour d’une bonne table… Chez vous de préférence, parce que mon chef cuisinier, un cordon bleu hors pair, a quitté le navire. Donc, ce serait plus pratique chez vous, et à la bonne franquette surtout ! Oui, à la fortune du pot, enfin autour du pot, parce que pour la fortune, tout reste à construire ! Mais nous le ferons ensemble, pas à pas, et un jour, c’est moi qui vous inviterai, vous, tous ceux qui m’auront convié à leur table, et nous sablerons le champagne pour fêter notre pays reconstruit. Faites-vous moi confiance, la poule au pot remijotera un jour prochain sur vos fourneaux, prémisse de notre brillante réussite collective. Et je choisirai mes ministres parmi ceux qui m’auront le mieux régalé, et ça n’en sera que justice ! Je ne suis pas un ingrat, vous pouvez compter sur moi.
Avant de rendre l’antenne, sachez que pour avoir votre président à votre table, vous devez vous inscrire au « 7575 #bonne chère ». Le plus tôt sera le mieux car nous avons grandes choses à discuter.
Mes chers compatriotes, votre président vous remercie de votre indéfectible confiance et vous donne rendez-vous…chez vous !!!
De Marie-Josée
Pacha
Il faisait encore nuit noire quand les ronflements de Martial me réveillèrent. Cet ours mal léché, et je sais de quoi je parle, avait ravi ma place pour de bon, je ne comptais plus que pour du beurre. À la pendaison de crémaillère, Lilly avait sablé le champagne et ce fut le début de mon malheur. Elle n’avait pas l’habitude de boire et après quelques coupes, la voilà pompette, autant dire que c’en était fini de son discernement. Elle m’avait pris dans ses bras et avait dit entre deux hoquets :
-Martial, je te présente Pacha, l’homme de ma vie, faudra t’y habituer.
J’en ronronnais de plaisir, mais la deuxième partie de la phrase m’intriguait. J’ai flairé d’emblée le danger, et il récolta un coup de griffe lorsqu’il tendit la main vers moi. Autant mettre les choses au point dès le début, il n’allait quand même pas s’imaginer que je lui témoignerais la moindre sympathie, il allait falloir veiller au grain.
Jusqu’à présent, j’ai toujours défendu mon territoire avec succès, ses prédécesseurs n’ont jamais fait long feu, à part Martial qui était un vrai gentil. Il n’a pas bronché quand j’ai déchiré le rideau, gratté le canapé, cassé le vase et sauté dans son assiette; il riait même de mes bêtises, disant que cela mettait de l’ambiance. Sa présence avait quelques avantages, c’était un cordon-bleu et quand Lilly avait les yeux tournés, il laissait tomber des morceaux de poulet ou de poisson dont il savait que je raffolais. Il n’a pas tenté de me chasser de la chambre pour dormir et pour comble de bonheur, il ne ronflait pas et me gratifiait de caresses de temps à autre.
J’ai donc fait contre mauvaise fortune bon cœur et la cohabitation se passait à la bonne franquette jusqu’à ce jour fatidique où ils se sont séparés. Lilly me prit à partie, je n’avais pourtant pas fait plus de bêtises que d’habitude, j’avais seulement succombé aux charmes d’une belle rousse et je ne suis pas rentré pendant quelques jours, pas quoi fouetter un chat si j’ose dire. Lilly avait refusé de partir en vacances avec Alex sans moi, c’en était de trop pour lui. Il fit illico ses valises, mais je ne suis pas certain que c’était l’unique raison de leur rupture, allez savoir, ce qui se passe dans la tête des humains. J’avoue que ma maîtresse était parfois une énigme pour moi aussi. Elle avait roulé dans la farine Pierre et Jacques et je ne comprenais pas pourquoi elle restait inconsolable du départ d’Alex. J’ai bien redoublé d’efforts pour la consoler, mais rien n’y faisait, elle restait triste et j’en étais même arrivé à regretter d’être à nouveau le coq en pâte. Elle avait repris le dessus quand elle avait déniché la maison de ses rêves et décidé de s’y installer. J’étais également aux anges, je faisais rarement chou blanc lors de mes virées nocturnes, mais cette embellie fut de courte durée et à présent le torchon brûlait.
Rien n’allait plus entre Martial et moi. Je faisais le dos rond dès que je l’apercevais et j’avais beau essayer de mettre de l’eau dans mon vin, rien n’y faisait. J’avais bien compris que je ne faisais pas le poids face à ce nouvel adversaire quand elle ne dit mot lorsqu’il posa mon panier dans le couloir en plein courant d’air et m’interdit l’accès à la chambre. Il ne pouvait pas s’empêcher de me donner un coup de pied dès qu’il en avait l’occasion en murmurant: sale bête.
Les carottes étaient cuites, je ne voyais plus qu’une solution : retourner dans mon ancien quartier, même si ce n’était pas la porte à côté, et tenter de trouver asile chez Alex. Je ne pouvais plus rester une heure de plus dans cette maison. Je m’étirais longuement et fis ma toilette avec soin. Je passais devant l’assiette de croquettes dont il ne restait que celle que j’avais boudée la veille. Je l’avalais à la hâte et me faufilais dehors avant que Lilly ne se réveille. Il faisait froid et le sol mouillé ne tarda pas à salir les coussinets blancs de mes pattes.
Mes pensées allèrent vers Lilly, comment allait-elle réagir quand elle se rendra compte que j’ai disparu. Serait-elle triste? Ira-t-elle à ma recherche? Sera-t-elle dans le même état que lorsque Alex est parti? Si tel était le cas, ce sera au tour de Martial de la ramasser à la petite cuillère, ce n’est plus de mon ressort.
Le trajet s’avéra plus long que prévu et pas la moindre souris en vue pour apaiser la faim qui me tenaillait. Par chance, j’ai trouvé une grange où passer la nuit et la paille était une excellente couchette et un garde-manger de surcroit. Je quittais à contre-cœur cet endroit douillet, mais j’avais encore de la route à faire. Au bout de quelques jours d’errance, j’arrivais épuisé et affamé chez Alex. Il a eu du mal à me reconnaître, ce périple avait quelque peu malmené ma superbe. Etonné, il me bombardait de questions :
-Mais qu’est-ce que tu fais là? D’où sors-tu? T’es-tu encore échappé? As-tu pensé à Lilly? Elle est sûrement morte d’inquiétude.
La queue entre les James, je répondis avec quelques miaulements à peine audibles et m’appelait sur le sol. Il enchaîna :
-Tu as de la chance, il me reste du poulet, si mes souvenirs sont bons, il me semble que tu en raffolais. Après ce repas, un petit somme s’imposait. Il m’installa confortablement sur le canapé, bien calé dans les coussins. Je le gratifiais d’un coup de tête, ronronnais d’aise, bien loin de cet infâme Martial.À mon réveil, quelle ne fut ma surprise quand Lilly me prit dans ses bras et me couvrit de bisous.
-Dieu soit loué, tu es sain et sauf! Mais qu’est ce qui t’a pris de te sauver ? Dans quel état tu t’es mis! Ne t’inquiète pas, je vais bien m’occuper de toi.
Un rapide coup d’œil aux alentours me rassura, Martial n’était pas là. Je me suis mis en boule et les yeux mi-clos, j’ai suivi leur conversation qui prenait une tournure inespérée. Lilly expliquait que Martial était une erreur de casting et qu’elle ne pourrait pas continuer de vivre avec quelqu’un qui n’aimait pas les animaux. Je me dis, en mon for intérieur, si cela se trouve, ces deux-là vont se remettre ensemble. Les yeux de merlan frit d’Alex confirmèrent mon intuition et d’un bond, je me suis installé sur ses genoux en signe de consentement.
Le message fut bien reçu et, pour tout vous dire, je me serais volontiers passé du nœud papillon, le même que celui d’Alex, qu’ils mirent autour de mon cou le jour de leur mariage, c’était le prix à payer pour mes bêtises. Las des festivités, je n’ai pas pu m’empêcher de rejoindre la belle rousse qui se pavanait le long de la clôture sans me douter que bientôt, je serai le dindon de la farce, mais ça, c’est une autre histoire.
De Dominique
Un type bizarre.
Peter est un type bizarre, un exclu de la société. Rejeté par le système scolaire dans lequel il n’a jamais trouvé sa place, il est devenu un paria, un marginal. Gaillard bien bâti, il est rodé au travail manuel et arpente souvent les marchés de Maisonneuve, sa ville d’adoption. Il vit de petits boulots en petits boulots, de camions à décharger pour quelques billets. Il a 19 ans et ne sait plus qui il est. Le cœur plein de rancœur et de revanche à prendre sur la vie, il en a marre d’être « le dindon de la farce ». Parfois, à la fin d’une journée bien gagnée, il s’en va traîner son pull délavé et son jean crasseux à la taverne « La fortune du pot ». La patronne n’exulte pas de joie en le voyant s’installer. Il a toujours la colère à fleur de peau et elle le surveille comme le lait sur le feu. Lui, aime l’auberge, c’est son petit refuge de paix providentielle quand il ne se « sent pas dans son assiette ». Il s’assied seul, toujours à la même table et commande sa pinte de bière et un sandwich au jambon beurre. Il voit les gens qui le dévisagent de la tête aux pieds. Bernard, l’homme à tout faire de l’auberge, videur à ses heures, est chargé de la surveillance de Peter, cette cocotte-minute toujours prête à exploser. « Nanard », pour les intimes, a du bagout et de l’expérience en coups « foireux », c’est le « Bad boy » de l’établissement. Il est malin comme un vieux singe et pour anticiper les coups tordus du fougueux jeune homme, il engage la conversation.
-Alors mon gars t’a passé une bonne journée ?
-Ça va, j’ai déchargé une dizaine de camions et j’ai de quoi vous payer mon « jambon beurre » si c’est ça qui t’inquiète ?
Nanard ne relève pas l’allusion qui lui est directement adressée, ce n’est pas le moment de mettre de l’huile sur le feu, il est là pour « veiller au grain » et pas le transformer en « pop-corn ». Tout à sa discussion, Peter reluque la petite serveuse que tout le monde appelle « Ninon ». Il en pince pour elle depuis toujours mais, comment pourrait-elle s’intéresser à lui, le modeste ouvrier sans le sou.
Nanard, fin observateur lui dit : « Elle te plaît la petite n’est-ce pas ?
– Je reconnais que c’est une chouette môme, y en a même qui laissent courir le bruit qu’elle serait ta fille ?
– Ne dis pas de bêtises mon gars et laisse les gens jaser. Ceci dit, si ton portefeuille pouvait se remplir un peu, je suis sûr que Ninon ne te dirait pas non. Tu es plutôt « beau gosse » dans ton genre. Tu n’en as pas marre de « compter pour du beurre » dans cette société de consommation, tu n’as pas envie de te la couler douce un peu pour vivre au soleil comme un « coq en pâte ? »
Peter, intrigué par ce discours lui dit :
-Où veux-tu en venir Nanard ? Tu as quelque chose à me proposer pour faire grossir ma part de gâteau ?
-Oui mais pour ça, Il te faudra rester discret et c’est une affaire sans risque dans laquelle tu as tout à gagner mais, faut pas de bavardage intempestif. Je t’explique : j’ai une copine, Lucette, qui fait le ménage au domicile de l’antiquaire, tu sais celui qui habite le manoir « bois du cerf ». Samedi, il part en week-end et il laissera toutes les recettes du mois dans son coffre. Lulu, qui n’est pas née de la dernière pluie, l’a vu écrire le code du coffre sur un « pense-bête » près du téléphone. La combinaison change tous les mois et notre antiquaire, qui n’a pas la mémoire des chiffres, l’a griffonnée sur son carnet de notes et l’a placée en sécurité dans son portefeuille.
-Et alors, comment on l’ouvre ce coffre si ton bourgeois garde sa formule magique dans la poche de son veston ?
C’est alors que le boss de l’auberge lui met sous le nez le code secret marqué en surimpression par le stylo de l’antiquaire.
-Lulu a eu le réflexe de récupérer le feuillet marqué de l’empreinte comme un négatif de photo, je sais, ça n’est pas moral mais bigrement malin. Alors qu’est-ce que tu dis de ça ?
Peter, se voyant déjà riche et sans réfléchir davantage :
-Ça marche je suis partant. Mais quels seront les intérêts de chacun, je fais le coup, j’empoche le fric et toi tu m’applaudis sans contrepartie ?
-N’exagère pas mon coco, ma contrepartie c’est la reconnaissance de dette de jeu que j’ai signée pour lui. Le document est bien au chaud dans son coffre. Je te laisse le fric et je récupère « l’ardoise » qui ainsi s’effacera d’elle-même. Si tu es partant, je te donne rendez-vous samedi vers 22 heures, Lulu aura laissé la fenêtre du premier étage ouverte. Il te suffira d’escalader le treillis supportant le lierre et tu pénètres dans la place. Le coffre se trouve dans le bureau de l’antiquaire au même étage.
-Marché conclu, dit Peter en serrant la gosse main ferme de Nanard.
Nous y voilà, le moment est venu. La nuit est profonde et sans lune. Peter est au pied du mur. Équipé de sa panoplie de « monte-en-l’air », il regarde vers la fenêtre ouverte qui l’attend là-haut, Il agrippe le lierre et gravit l’obstacle en s’appuyant sur le treillis de bois. En quelques brassées, le voilà à destination, un jeu d’enfant pour sa svelte silhouette. Il saute dans la pièce et sait qu’à présent il ne peut plus reculer. Plongeant la main dans son sac à dos posé sur le plancher, il sort la lampe de poche. Le faisceau lumineux fait comme une trouée dans l’obscurité. Le silence est pesant ; « j’espère que la maison est vraiment vide » pense-t-il en cherchant la porte qui mène vers le couloir central. Sa lampe balaye l’espace vers le plafond, la droite, la gauche. De magnifiques tableaux décorent les murs, il reviendra un jour pour s’en occuper ! « Ah, voilà la sortie, allons-y ». En quelques pas, il rejoint le couloir et aperçoit au fond, le bureau du maître de maison.
Mais, quel est ce bruit ? Le voilà pétrifié. Il éteint sa lampe et ne bouge plus, tous ses sens sont en alerte. Patiemment, il attend, des gouttes de sueur inondent son dos. Après quelques instants de temps suspendu, le silence revient, à tâtons le pouce de la main droite cherche le bouton de la lampe. Devant lui, deux yeux électriques d’un vert étincelant brillent dans la nuit, cette image lui glace le sang et le fait sursauter.
« C’est quoi cette maison, dans quelle galère me suis-je donc fourré ? », tout en se mettant à l’abri dans l’angle d’un mur. Le cœur palpitant et la trouille au ventre ; « si je fais demi-tour, maintenant tout le monde se moquera de moi à l’auberge. Je n’aurai plus grâce aux yeux de la belle Ninon. Il me faut continuer, je n’ai pas le choix ». Autour de lui, les bruits résonnent, s’amplifient, deviennent prégnants, il n’a qu’une envie ; s’enfuir. Au bout à droite, une porte en bois avec une plaque en cuivre s’impose : VANDENENDE Christian-Antiquaire. « C’est là, je touche au but, pourvu que la porte ne soit pas verrouillée ! » Peter cherche la poignée, elle est fermée, la poisse est avec lui. Sur un piédestal trône une statuette de bronze, c’est un cerf, l’emblème de la famille VANDENENDE. Et si… Peter soulève la lourde pièce, la clef est là posée dessous avec une naïveté confondante. C’est à présent un jeu d’enfant que d’y entrer. Un nouveau balayage lumineux transperce la pièce, le coffre lui tend les bras. Il compose avec application le code, un déclic et c’est le Graal. C’est mieux qu’au loto, on y gagne à tous les coups. La porte s’ouvre avec volupté, à lui l’enveloppe pleine à craquer de beaux billets et la reconnaissance de dette de Nanard.
La victoire est belle et savoureuse, ça va être la fête à l’auberge. Le carillon sonne 23 heures et à chaque heure écoulée, le système de sécurité s’autoscanne et repère très vite la fenêtre de l’étage ouverte. Une sirène stridente se déclenche, toutes les issues se bloquent irrémédiablement. Peter s’affaisse contre le mur. Sa lampe éclaire de nouveau les grands yeux verts métalliques qui l’avaient effrayé tout à l’heure, ce sont les yeux du chat s’avançant vers lui en quête de caresses amicales.
« C’est la fin des haricots. », Les carottes sont cuites et bien cuites.
De Khadija
Les débuts du printemps s’annonçaient admirablement bien. Cependant, au lieu d’être détendue et décontractée, je ne me sentais pas dans mon assiette. En effet, je pensais à toutes la liste de bouquins que je devais non seulement résumer, analyser, mais aussi faire des fiches pour chaque thème qui s’y trouvait, avant le jour J ; et Dieu me garde si je ne réussis pas, ça sera la fin des haricots.
Néanmoins, je décidai d’aller rendre visite à mes amis étudiants qui habitaient le logement Crous, il était midi lorsque je sonnais à leur porte, et comme c’était à l’improviste, je déjeunai à la fortune du pot.
Rose, ma copine de classe, était issue d’un milieu très aisé, et si elle avait décidé d’entreprendre des études supérieures, c’est uniquement par ostentation. En effet, elle vivait comme un coq en pattes. De temps en temps, elle avait la fâcheuse tendance de me poser des questions sur mes origines et mes intimités, mais j’avais bien un bœuf sur la langue, et divulguer mes petits secrets n’était pas ma tasse de thé.
Un beau jour, Rose m’invita pour participer à une abondance que ses parents avaient confectionnée. Moi qui étais issue d’un milieu indigent, je décide d’y aller habillée simplement d’un pull et d’un jean. Dès mon entrée dans le salon, il se fit un grand silence. Des regards méprisants me dévisageaient. A ce moment, je compris que je comptais pour du beurre.
Mais, la bande vorace eut vite fait de se détourner de moi pour foncer tête baissée et avide dans les grands et somptueux plats qui s’y trouvaient, et faire bonne chère ; on entendait des tintillements de verres qui se cognaient entre eux, des bruits de fourchettes qui raclaient les fonds des assiettes, des éclats de rire, des discussions … les gens enivrés par leur instinct animal, engouffraient la nourriture à en perdre le souffle … un brouhaha et un vacarme énorme emplissaient les lieux . Soudain, le maître du manoir imposa le silence … afin que l’on puisse commencer à sabler le champagne au nom de la nouvelle demeure, et pour enfin signaler qu’ils avaient pendu la crémaillère.
De retour chez moi, ma colocataire Emma était en train de confectionner un gâteau à la crème et me dit :
-J’ai des amis qui viennent demain pour faire un fool moon party, ils seront à peu près une dizaine de personnes, et il faut bien que je leur prépare quelque chose. Et justement, je viens d’enfourner les biscuits, ça sera une pièce montée, alors je te demande de veiller au grain car j’ai encore quelques courses à faire.
Entre-temps, je me suis enfermée dans ma chambre afin de reprendre le cours de mes révisions. Soudain, j’ai eu un sursaut lorsque je sentis l’odeur du cramé inonder l’appartement, le fameux biscuit d’Emma venait de brûler ! Un misérable amas de charbon s’érigeait face à moi ! Paniquée, je suis restée comme deux ronds de flan. Je descendis les escaliers de l’immeuble en courant, il fallait absolument remédier à ce terrible incident !
Arrivée au centre-ville, je m’engouffrais dans une petite pâtisserie, les étalages étaient plein de petits bouchées mignonnes et multicolores ! Il y avait aussi des cookies, des bretzels, des babas et des brioches. Je décidai d’en prendre quelques kilos de chacune. Au fond de moi-même, je pensais bien faire, car Emma croirait que je l’avais roulée dans la farine !
Quelques heures plus tard, Emma était de retour, et se précipita vers le four. Je l’interceptai à temps et lui fit part de ce qui s’était passé. En demi-teinte, elle passa l’éponge, et d’un air soulagé, elle me remercia d’avoir remédié à l’incident. Si non, elle aurait pu passer aux yeux de ses camarades comme le dindon de la farce.
Le soir venu, nos amis étudiants se regroupèrent dans le jardin de l’immeuble sous la pleine lune. Ils dansèrent heureux et insouciants, trinquèrent, mangèrent à la bonne franquette !
D’Hervé
LA CUISINE D’ALFRED
C’est souvent dans les films de ce bon père Hitchcock
Que l’on croise, surpris, de vagues ou fiers bonshommes,
Des suspects trop parfaits qui font parfois les coqs,
Mais surtout se retrouvent en plein capharnaüm.
Comptant pour du beurre et roulés dans la farine
Plus souvent qu’à leur tour, saisissent-ils le sens,
Ces héros malmenés, de tant de pantomimes ?
Ils découvrent fort tard toutes les manigances
Du maître incontesté; lui seul tient dans sa nasse
Les fils et les intrigues et les voies sans issue,
Les pièges et les surprises qu’en dindons de la farce
Ses personnages éprouvent ! Et je suis assidu
A ces brillants frissons qu’en spectateur tenace,
Mi-figue, mi-raisin, je dévore tout crû …
Alors, vous êtes-vous bien régalés? Je vous l’avais dit, c’est truculent!
La langue française est si riche en expressions de toutes sortes. C’est incroyable comment on peut jouer avec les mots! Cela est même fascinant!
Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures d’écriture.
Pörtez-vous bien et prenez soin de vous!
Créativement vôtre,
Laurence Smits, LA PLUME DE LAURENCE