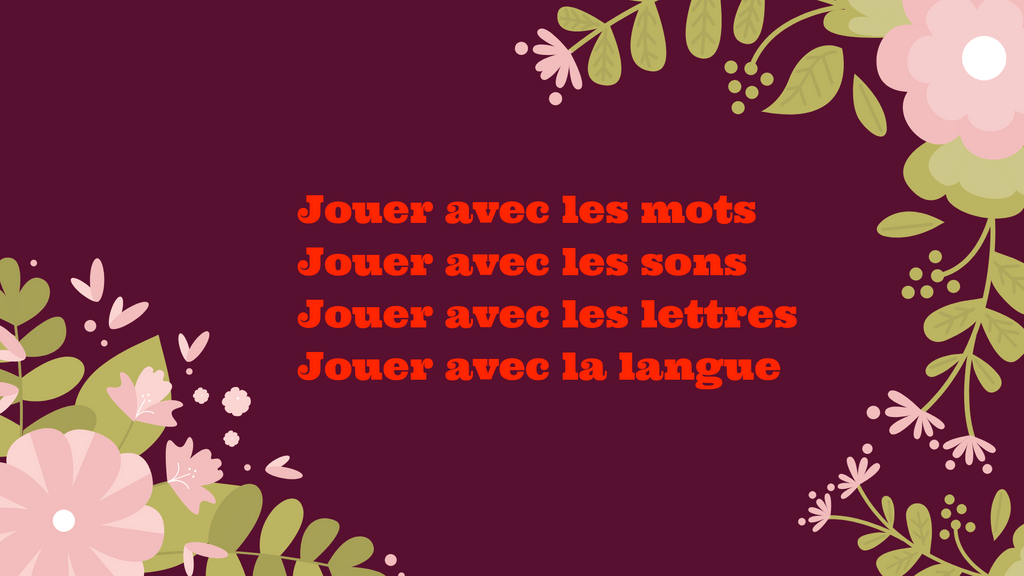J’ai adoré lire vos textes de la proposition d’écriture N° 161 sur les rues de votre enfance. On y retrouve beaucoup de points communs.
Beaucoup de celles et ceux qui écivent sont plus ou moins de la même génération.
Voici vos textes. Je vous en souhaite une belle lecture.
De Catherine
LA RUE DE MON ENFANCE
« Hello, le soleil brille, brille, brille … ».
C’est par cette ritournelle qu’il s’annonçait. Une mélodie de boîte à musique pour signaler son arrivée quotidienne, devenue un rituel pour nous tous. Nous n’avions ni montre, ni téléphone portable bien sûr, mais nous savions tous quelle heure il était à ce moment-là. Alors, d’un coup, les enfants disparaissaient du paysage, courant vite chercher quelques pièces de monnaie. Les chiens du quartier, au contraire, montraient vite leur museau sachant qu’ils auraient droit à quelques gourmandises, tombées d’une main maladroite. Il était là, devant ma maison, dans son petit camion rose et vert, couleurs pastel, et il attendait ses petits clients. Le marchand de glaces avec ses cornets remplis de couleurs différentes en fonction des goûts de chacun était notre préféré. Bien sûr, tout au long de la journée, il y en avait d’autres, des commerçants ambulants : le rempailleur, le marchand de pommes de terre, le ferrailleur, les aiguiseurs, la laitière, et l’épicière qu’on aimait beaucoup également car l’arrière de son camion, quand il s’ouvrait, nous laissait apercevoir, et désirer, toutes sortes de bonbons multicolores et odorants.
Un joyeux désordre s’installait alors pendant quelques minutes, le temps que chacun fasse son choix, ou plus exactement fasse semblant d’y réfléchir car nous savions très bien ce que nous voulions, et nous sentions déjà le goût de notre parfum favori sur le bout de notre langue.
Puis, c’était le silence : on dégustait.
Et enfin, reprenaient les jeux interrompus, les discussions, la joie, le bonheur d’être ensemble, les rires, l’insouciance… Parfois les bagarres, les jalousies ou les fâcheries, mais qui n’altéraient pas l’ambiance bon enfant qui régnait dans ma rue, ce lieu de vie où nous nous retrouvions, amis et familles pour échanger.
C’était une grande rue, très longue, qui montait. Elle était bordée de maisons, toutes identiques mais parfois de couleur différente, jumelées deux par deux, avec chacune son jardinet, tout petit devant et un peu plus grand derrière. Mais l’endroit idéal était le trottoir, bien large, recouvert d’une terre sablonneuse, idéale pour jouer aux billes et construire des parcours immenses et biscornus. Le soir, sous nos ongles, nous retrouvions les petits cristaux de sable incrustés et brillants, doux souvenir des bons moments passés. L’hiver, nous nous aventurions même sur la route, recouverte de neige et désertée par les voitures. Pour ceux qui n’avaient pas de gants et qui ne voulaient surtout pas perdre de temps à aller les chercher à la maison, c’était l’onglée assurée. Un carton, un sac, peu importe l’ustensile, mais nous inventions notre luge et après une montée longue et fatigante, venait la joie de la descente, à toute vitesse, dans les cris d’allégresse et les encouragements des copains.
Tout en bas de cette rue, un mur, haut. Nous savions que derrière, se cachait l’hôpital psychiatrique, mais ce mot était très abstrait pour nous, encore trop petits pour comprendre. Alors nous inventions : les lieux, les résidents, les histoires qui s’y déroulaient et qui nous faisaient frissonner….
Tout en haut de cette rue, un petit cinéma de quartier avec une projection le jeudi après-midi. Découvrir « les aventures de la coccinelle » sur grand écran avec les copains et les copines : quelle merveille pour l’enfant que j’étais ! C’était déjà un apprentissage de la liberté à venir, car nous y allions seuls, juste accompagnés des recommandations parentales, mais dans un monde où la sécurité prévalait. A côté du cinéma, se trouvait la bibliothèque « Elsa Triolet » que je fréquentais assidûment. Les livres faisaient déjà partie de ma vie !
Dans ma rue, il y avait toujours de bonnes odeurs. Evidemment, elle était bordée de tilleuls qui dégageaient au printemps de doux effluves. Et puis, il y avait nos goûters préparés par nos parents et partagés sur ce coin de trottoir : pain tout tiède, chocolat, compote …. Mais c’est fin novembre que la rue entière s’emplissait du parfum âcre des pommes pressées. Les habitants s’organisaient, achetaient les pommes en grande quantité et faisaient venir la presse. C’était alors un jour de grande animation, plus encore que le jour de marché ! Après son passage, les tas de moût s’entassaient sur les trottoirs, de chaque côté de la rue, et l’odeur s’imprégnait partout pour quelques jours.
Vous la voyez ma rue ? Vous entendez ces conversations d’enfants, ces cris, ces rires ? Elle n’a pas changé. Enfin si, un peu quand même …. J’avais 8 ans et j’en ai maintenant 63. Mais mes souvenirs, eux, sont bien inscrits dans ma mémoire, peut-être embellis par ma vision enfantine du monde. Et mon souhait le plus cher serait que tous les enfants du monde puissent, à leur tour, dans quelques années, écrire le même texte, ressentir ce faisant, toutes les émotions de leur enfance et garder confiance dans les générations à venir pour renouveler les plaisirs dans un monde sans cesse en évolution !
Restons toujours un enfant, ne nous arrêtons jamais de goûter, de sentir, de voir, d’être enthousiasmés par les grandes choses que sont le ciel, les rayons du soleil, et les rêves qui nous éclairent.
D’Elie (proposition d’écriture N° 160)
La richesse des circonstances contraignantes
Pour qui connaît l’immensité du savoir, et pour qui les sources d’inspiration à la sagesse sont chères, alors les opportunités de voyage constituent de véritables creusets à s’enrichir pour la vie. Car la diversité et la beauté des sites géographiques dans les coins de la terre fournissent une mosaïque de ce savoir et la sagesse.
Zannou, un professeur émérite des sciences de la vie et de la terre, comprend toute la portée de cette vérité et a résolu de passer avec sa famille deux mois de vacances. A ce sujet, les enfants, Paulin, Jacqueline et Conforte ne cessaient de rallumer la flamme de cette envie de visiter la cité lacustre des Aguégués dans le département du Littoral et au Sud du Bénin. Cette cité est bien un grand ensemble des villes et villages dont les maisons, pour la plupart, sont bâties sur pilotis. C’est à ce lieu que l’on peut nourrir les yeux et l’imagination par les paysages naturels et les œuvres d’art du royaume des Toffinous, tant et si bien que ces maisons le sur lac Nokoué et ses affluents forcent l’admiration. Mais il faut noter avec bonheur que les habitants sous d’autres cieux ont bâti par endroits leurs maisons sur des languettes de terres parfois accidentées. Par analyse au sens des hommes, l’envie de passer ces moments de vacances ne présageait, à l’horizon, aucun obstacle pouvant empêcher la tenue de l’excursion.
Monsieur Zannou et sa femme, très préoccupés par le projet, ont consacré les un cinquième de leurs économies, soit la somme de 350.000 francs pour le projet. Dans la cour de notre concession, monsieur Zannou discutait de son projet avec son ami Fanou. Il relatait qu’il devrait habiller tous les cinq membres qui constituent sa famille et prévoir la restauration, l’hébergement, les risques éventuels pour un tel voyage et les besoins pour le plaisir touristique et l’épanouissement. Pendant que Zannou et Fanou s’entretenaient, je me tenais un peu à distance sous la paillotte en travaillant avec soin et tout le génie que cela nécessite à la fabrication de quelques paniers destinés l’utilisation par les femmes ménagères. J’analysais les biens fondés de telles vacances à la cité lacustre des Aguégués, sans toutefois appréhender les mobiles qui poussent à investir une telle somme pour les vacances alors que ces 350.000 francs pourraient servir à d’autres fins utiles. Je m’allongeai dans mon fauteuil en bois pour poser quelques questions à mon cousin Zannou, le professeur.
Mon cousin :
-Comment pourriez-vous investir 350.000 francs pour faire une excursion avec toute sa famille dans la cité des Aguégués que nous connaissons tous depuis la nuit des temps ? Ne voyez-vous pas que cette aventure est une perte de temps, d’argent et d’énergie ? Et ne mesurez-vous pas tous les risques que vous encourez en voulant conduire toute la famille dans ces milieux, qui d’ailleurs, sont très insalubres ?
D’un sursaut, monsieur, Fanou, se redressa de son siège et parla sur un ton courtois, aimable mais avec une vérité qui faisait appel à l’intelligence. Il déclara :
-Nous traversons des temps économiques des plus stressants car les emplois les plus rémunérés se raréfient, tandis les charges des ménages ne cessent de croître. Je souhaiterai que mon ami, Zannou, pense aux femmes de nos familles qui manquent de financement pour monter un petit projet d’affaires commerciales. Une telle action serait la bienvenue et profitable pour le bonheur et l’émergence de quelques familles pour sortir de la misère.
Zannou, le professeur des sciences de la vie et de la terre, donna la preuve de l’homme qui possède en lui un champ de savoir solide et vaste dans ses arguments. Il prit la parole dans le calme, l’amour et la prévenance afin de ne blesser ni humilier ses interlocuteurs. Et de surcroît, il se mordait les joues afin d’éviter l’étalage de son esprit de supériorité et de savoir.
-Mes bien-aimés Fanou et Elie, je vous remercie. Et je félicite aussi votre état d’âme et votre esprit ouvert et franc pour donner votre avis sur mon projet de vacances avec ma famille. J’ai suivi avec intérêt et passion les arguments fondamentaux que vous avez avancés. Ils sont, en toute honnêteté, légitimes pour qui a l’amour de la vérité. Mais pour qui hait la vérité, c’est la marche vers les couloirs noirs et périlleux. En parlant du développement, sachez que nous avons les nécessités pour le temps présent et celles qui préparent pour l’avenir.
En programmant ces vacances pour la famille, je désire mettre dans la vie des enfants les fondements pédagogiques pour leur éducation. Ils pourront mûrir dans leur esprit et éclore avec la succession des mois et des années pour enfin vous rejoindre sur les chemins dorés de vos arguments. Je brûle de cette vision, d’une part, à élargir leur esprit vers un spectre du développement plus profond. Plus vaste. Ils pourront empoigner les trésors du monde grâce à cette opportunité. Ces enfants, Paulin, Jacqueline et Conforte gagneront, grâce à cette seule excursion, les vertus, des portions de la science et la vie en société. Et dès lors, ils vont répandre autour d’eux la vraie philosophie qui conduit au développement social, matériel et financier qui est la base vos arguments.
D’autre part, s’il advenait de découvrir les habitants de la cité des Aguégués dans les conditions insalubres, misérables ou malheureux, je saisirai l’occasion de révéler à tous l’urgence de leur venir au secours avec la rage que ce défi leur impose à eux, et à nous qui sommes les parents de nos enfants.
Et pour la question de venir en aide aux membres de nos familles, vous avez raison car il est normal de sortir de la zone de l’égoïsme pour être utile auprès des pauvres. Des misérables. Pendant que nos entretiens prenaient racine dans les consciences, mon collègue Fanou et Elie répondaient par des signes d’accord et une situation inattendue se présenta. La grande sœur de Fanou vint dans la famille en furie et nous informa que leur petite sœur, qui était enceinte, entrait en travail d’accouchement et se compliquait depuis quarante-huit heures.
La nouvelle surprit tout le monde, nous avions besoin d’accéder aux escaliers du renoncement afin de sauver la petite sœur qui mourait de détresse. Le professeur se trouva dans un dilemme et dans l’embarras. Sa femme demanda que le projet de vacances soit ajourné.
Les hommes peuvent établir des projets, mais à l’évidence nous avons le devoir d’écouter la voix de ceux qui meurent et de les arracher de l’ombre de la mort pour la vie.
Zannou réagit en disposant la somme de 250.000 francs pour sauver la sœur en état d’agonie. Fanou et moi donnèrent chacun la somme 100.000 francs pour aider Sabine. Elle était sauvée grâce à une intervention chirurgicale et grâce à la bravoure et la détermination des médecins gynécologiques, des sage-femmes et de leurs aides.
Un homme, à lui seul, ne suffit jamais pour sauver de l’épée des calamités et de la mort. Mais, il faut de l’union de plusieurs personnes pour admirer les résultats des efforts de l’ensemble.
De Zouhair
Elle s’appelait rue Marin Lameslée, du nom de l’aviateur héroïque de la Deuxième Guerre mondiale. Elle était située dans le quartier dit « De l’aviation » car un aéroport militaire était installé non loin de là.
C’est la rue de mon enfance. Celle qui, jusqu’à l’âge de sept ans, je n’empruntais qu’avec d’infinies précautions. Puis dont j’ai fini par connaître la moindre portion.
Il y avait peu de maisons à l’époque et les automobiles étaient rares. C’étaient plutôt des bicyclettes, des charrettes et des vélo-solex qui sillonnaient la rue. Les trottoirs étaient en terre battue, une terre rouge et grasse dans laquelle on s’amusait à faire des petits trous. Vous saurez plus tard à quoi servaient ces petits trous.
Cette rue était bordée au sud par la pharmacie du quartier et, sur le trottoir d’en face, par le bureau de poste. Ils étaient remarquables car le premier possédait un petit muret d’environ cinquante centimètres de haut fait en pierres de taille, couleur or. Le muret faisait le tour de la pharmacie, comme pour signaler que ce lieu était exceptionnel. Un lieu de soin et de science.
Le deuxième était surélevé et on y accédait par des escaliers symétriques, l’un pour monter, l’autre pour descendre. Je faisais cette montée et cette descente avec cérémonie chaque fois que l’on m’accordait le privilège d’aller poster une lettre.
Ces deux bâtiments étaient mes repères et en même temps des frontières infranchissables.
En effet, au-delà de ces balises et jusqu’à l’âge de sept-huit ans, c’était une « terra incognita » et donc un domaine potentiellement dangereux.
Au début, je n’osais aller qu’à la boulangerie, située sur le même trottoir que la pharmacie, mais beaucoup plus proche de la maison. Mes parents m’y envoyaient chercher le pain que le boulanger cuisait dans un four à bois et, bien avant d’arriver à la boulangerie, l’odeur du pain cuit venait flatter mes narines comme une promesse de réjouissances célestes. Je me voyais déjà prélever un des pains ronds parsemé de grains de sésame, malgré l’interdiction faite par ma mère de ne pas y toucher avant d’être rentré.
Mais, je passais outre cet interdit et rompais le pain pour me délecter de cette mie encore brûlante et parfumée.
Un jour, je pris l’initiative d’aller promener le chien que mon grand frère venait d’acquérir. Je profitai du fait qu’il était au collège et que moi je n’avais pas classe. Tout se passa bien jusqu’à la boulangerie, puis il prit à Tika d’aller plus loin, malgré les appels que je lui faisais. Il arriva ainsi au niveau de la pharmacie, la limite que je m’étais promis de ne pas franchir. Mais cela ne l’empêcha pas, lui, de la franchir.
Cela ne devait pas être mon jour de chance car la fourrière rôdait par-là, capturant les nombreux chiens errants soupçonnés de transmettre la rage. Les deux hommes, un grand noir et un petit blanc, se dirigèrent vers le chien et moi, au lieu d’aller le chercher et montrer que c’était le mien, je me suis caché derrière ce fameux muret de la pharmacie en continuant à l’appeler. Ils finirent par l’attraper et je n’en revis jamais la trace.
Voilà pour le côté sud.
Côté nord, c’était encore plus terrible. Mes parents m’interdisaient d’y aller car s’y trouvait un bidonville mal fréquenté. Mais ma tante n’habitait pas loin de ce bidonville et j’aimais bien aller y trouver ma cousine. J’étais d’autant plus attiré par ce côté qu’il s’y trouvait une merveilleuse pâtisserie où l’on vendait d’énormes boules de chocolat fourrées à la pâte d’amande.
J’empruntais alors la rue dans cette direction avec tout le courage qui me caractérisait, prêt à détaler à la moindre apparition d’un de ces petits chenapans qui seraient capables de m’arracher la boule en chocolat des mains et en plus de m’insulter car j’habitais une villa.
Lorsque j’arrivais à franchir cette autre frontière, un nouveau monde s’offrait à moi. Ma tante habitait une cité où il y avait un buraliste, une mercerie, plusieurs épiceries et un square avec des jeux. Ma cousine et moi achetions des bonbons et allions jouer au parc. On se sentait protégés car, pas loin, se trouvait la « cité-police » où étaient garées quantité de Renault Dauphine, voitures officielles de la police à l’époque.
Toutefois, je surveillais l’heure et appréhendais le chemin du retour. Je repartais bien avant la tombée de la nuit, afin d’éviter toute mauvaise rencontre. A propos de nuit, j’osais un jour aller regarder la télévision chez un camarade de classe. Les films ne passaient qu’à partir de neuf heures du soir. Au retour, il fallait marcher sur une cinquantaine de mètres dans le noir total car l’éclairage public n’était pas encore installé dans notre quartier.
Je me souviendrai toujours de ces cinquante mètres que je parcourais à petits pas, guettant le moindre bruit, le moindre mouvement provenant des buissons et des haies qui bordaient les maisons. Je ne fus rassuré que lorsque je commençai à sentir l’odeur sucrée et enivrante du chèvrefeuille de mon jardin.
Ah, quel merveilleux jardin c’était. Rempli de pruniers, d’abricotiers et d’orangers. Nous fournissions toute la famille en fruits. Mes préférés étaient les abricots. Le goût qu’ils avaient, je ne l’ai jamais retrouvé ailleurs. Si, peut-être un peu dans la Drôme provençale, chez des amis.
Et voilà à quoi servaient les petits trous dans la terre : si l’on arrivait à placer le noyau d’un abricot directement dans un trou, on doublait la mise. Sinon, s’il se mettait sur le côté, on l’avait perdu. On appelait ce jeu « La boutique aux noyaux » et ceux-ci étaient pour nous de véritables trésors.
De Jean-Robert
– Non, je ne peux pas. Je ne vais pas y arriver.
– On peut essayer.
– Non ! Vous vous souvenez de la fois où je vous ai parlé de la maison ? Cette grande maison, vide. Dans laquelle je sais que j’ai grandi au milieu de plusieurs frères et sœurs, enfin pas au milieu mais tout à la fin, mais qui reste vide. Complètement. Je peux traverser chaque pièce sans jamais y rencontrer personne.
– Oui, je me rappelle ce cauchemar récurrent.
– Eh bien c’est exactement pareil en dehors de la maison. Le vide, le désert, le silence…
– Le silence ?
– …
– …
– Non ! Pas le silence… Plutôt…
– Oui ?
– La maison était située en plein carrefour, en face d’un cinéma, d’un café-tabac et d’un garage, aux trois autres angles du carrefour. Qui faisait aussi station-service. Le garage, je veux dire.
– J’avais compris.
– Alors forcément, tout cela était bruyant : les sorties du cinéma et les gens qui se racontent le film, les voitures qui redémarrent et prennent leur élan, les buveurs qui tentent de redémarrer. Toute la journée et même tard dans la nuit. Je sais que mes parents trouvaient ça insupportable…
– Ils se plaignent ?
– Oui. Mais non ! Je les entends râler contre tout ce bruit qui les empêche même de dormir. Moi, ça me rassure plutôt. Mais je ne les vois toujours pas. D’ailleurs c’est pour cela qu’on a déménagé : pour fuir le bruit.
– Pas de silence donc. Mais toujours le désert ?
– Ça ne va pas !
– Vous voulez faire une pause ? Un verre d’eau ?
– Voilà c’est ça. C’est ça qui ne va pas : le mot, désert. Parce que le désert, c’est chaud et sec. Alors que là-bas, ou là-haut, dans la ville du carrefour avec ma maison, il ne faisait jamais vraiment chaud et surtout rarement sec. En plus de se plaindre du bruit, je sais que ma mère maudissait ce temps toujours pluvieux. Elle venait du sud, vous comprenez ?
– Oui, je vois.
– Moi, je ne vois toujours personne. Mais je me souviens du pont, juste à la sortie du carrefour, qui enjambait la rivière qui débordait quand il avait trop plu. Souvent. Et le saule pleureur qui débordait d’un jardin. Et l’odeur des fleurs. Du lilas, des roses, de la glycine, du chèvrefeuille. Les pissenlits, ça ne sent rien et c’est plutôt sur les trottoirs qu’ils poussent. J’aimais bien quand ils formaient leur boule de poils sur lesquels on soufflait, comme la dame sur la couverture des dictionnaires. En faisant un vœu, comme quand on soufflait sur les bougies d’anniversaire.
– Oui.
– Il y avait un pâtissier pas loin, ou plutôt une boulangerie-pâtisserie. Et aussi une pharmacie, une épicerie, une fleuriste, une boucherie-charcuterie devant laquelle des poulets tournaient sur leur broche. Je revois bien les poulets, mais c’est surtout grâce à leur odeur de grillé. Et les fleurs de la fleuriste, mais qui sentaient moins fort que le chèvrefeuille.
– Et le boucher, la fleuriste, le pharmacien, l’épicier ?
– Non, toujours personne. La rue est vide. Le carrefour est vide. Peut-être que toute la ville est vide.
– Quelle solitude !
– Oui… Non, attendez ! Il y a quelqu’un. C’est le serveur du bar-tabac d’en face. Il arrivait à vélo pour prendre son service. Enfin je crois. Il est arrivé trop vite ou alors il a voulu éviter un piéton sur le trottoir ou il n’a pas été évité par une voiture qui sortait du garage.
– Oui ?
– Alors son vélo a dû heurter le rebord du trottoir et il est tombé, juste devant la vitrine du tabac sur laquelle il y a marqué quelque chose : bar, tabac, PMU et billard peut être. Sûrement pas Loto ; ça n’existait pas encore. Le vélo est couché sur le trottoir. Et le serveur à côté.
– Vous voyez ? Il y a enfin quelqu’un.
– Mais il ne compte pas : il est mort. Il est couché dans son sang. Et si je m’en souviens, c’est à cause de la silhouette, que les flics ont tracée sur le trottoir. À côté d’une touffe de pissenlits. En souvenir de l’accident. Ils ont même tracé la silhouette du vélo.
– Bien. On va s’arrêter là. Je vous attends la semaine prochaine.
En sortant du cabinet du psy, j’ai été renversé par un vélo. Je ne suis pas revenu la semaine suivante : j’étais mort.
De Françoise V
Dans ma rue,
Je les ai toutes vues, les noires, les blanches
Venues d’ici et d’ailleurs ou d’Outre-Manche
Les bleues, les vertes
Berlines fermées ou découvertes
Ces automobiles à essences
Libérant leurs odeurs entêtantes et toutes leurs puissances
Qu’elles étaient bruyantes !
Sans gêne et klaxonnantes.
Dans ma rue,
J’aimais ce petit magasin nommé « La Ruche »
Le meilleur commerce de Noël pour vendre la « bûche »
Ma mère m’envoyait acheter
Toute l’épicerie qui pouvait lui manquer
Et j’adorais tâtonner et toucher
Fruits et légumes mures, prêts à être goûtés
D’ailleurs le gérant qui me connaissait bien
M’autorisait à croquer une pomme sucrée, quelle chance ! je me souviens.
Dans cette même rue,
Habitait ma chère grand-mère avec sa télévision
Elle m’invitait à regarder des émissions
J’avais droit à « Bonne nuit les petits » après l’école, après l’étude
Le jeudi c’était Zorro, et le « Petit train d’interlude ».
Elle m’offrait des chips, des caramels
Que ma mère m’interdisait, mais que j’adorais, rien de criminel !
Un secret partagé entre ma grand-mère et moi
Qui me gardait parfois sous son toit.
Dans ma rue,
Nous inventions des jeux d’enfants
Grâce à nos imaginations tout bonnement
C’était en automne avec mes copines
Nous sautions dans des tas de feuilles douces, que d’adrénaline !
Que de rires, de joie, et de cris
Pour occuper tous nos après-midis
Nous étions reines et rois tout à la fois
On se réchauffait, on n’avait pas froid.
Bien plus tard, dans ma rue,
Derrière ma fenêtre, je guettais l’auto de mon amoureux
Qui passait à toute vitesse, pressé et heureux
Après sa journée de travail il rentrait chez lui
C’était toujours avant la nuit.
Moi je l’attendais
C’est l’année où j’étudiais
Je l’ai attendu ….attendu,
Et il n’est jamais venu.
De Catherine G
Chez moi – Quartier du Merle Blanc… Rue du Verger…
Sur les hauteurs de la petite ville, des petites maisons à un étage, nées sextuplées avec mitoyenneté, siamoises de six autres en léger décalage, toutes chapeautées du rondouillard château d’eau qui les domine de sa hauteur sympathique et sonne l’alarme tous les premiers mercredis du mois, histoire de tester sa voix.
Quartier du Merle Blanc… Rue du Verger…
Ça sonne comme la campagne en ville. Nouveau quartier des années soixante, pour un accès à la propriété de familles d’ouvriers, moyennant moult sacrifices. Mais la vue sur la vallée de La Creuse et la ville fut vite occultée par les premiers HLM à deux étages, faisant vibrer la rue de joyeux cris d’enfants. Derrière les petites maisons, la campagne s’étendait à perte de vue au bout des jardins clos qui abritèrent nos premiers jeux, en parallèle de ceux des voisins. Parfois, le grillage qui nous séparait était intégré dans nos scénarios communs. Pas question de sortir de l’enclos pour des jeux en autonomie, pas avant d’avoir fait ta communion qui te dotait de ton premier mini-vélo et par conséquent, d’un accès à la piste bétonnée derrière la maison : premier avant-goût de la liberté.
Quartier du Merle Blanc… Rue du Verger……et sa vie sociale.
Les bavardages des pères qui jardinaient à l’arrière, les commérages entre mères en attendant le passage des commerçants, chacun y allant de son klaxon pour rameuter la ménagère : la laitière en 2CV camionnette transportant les énormes bidons de lait encore tiède, le boulanger auquel on achetait une couronne (à celui-là et pas à l’autre, parce que lui, on le connaissait d’un autre quartier et on me pesait bébé sur la balance de son fournil), le coopérateur et son petit fourgon qui s’ouvrait à l’arrière pour faire comptoir abrité, le boucher et son tablier peu ragoûtant dans son vieux camion Peugeot…Je passe sur le marchand de peaux de lapin, vélo et petite remorque, qui, une fois par mois, hurlait à tue-tête : « Maaarchand d’peaux d’lapin ! Maaarchand d ‘peaux d’lapin ! »
Le top du top, années soixante-dix, c’était le premier supermarché ambulant, tout droit venu de la préfecture : un grand car aménagé où on entrait par le fond pour prendre un panier de plastique rouge avant de sillonner les rayonnages, où nous découvrîmes entre autres les premiers chocolats de notre vie, ceux emballés individuellement et reliés ensemble en accordéon (future récompense contre une bonne note dans le cahier mensuel). On payait à l’avant du bus, au niveau du chauffeur, où trônait une caisse enregistreuse fascinante pour nous qui ne connaissions que le duo papier crayon des autres commerçants. Une vraie fête au quartier, attendue chaque mois avec fébrilité, d’autant que chez « Seron frères, c’est moins cher » !
Quartier du Merle Blanc… Rue du Verger…… et sa population hétéroclite :
la veuve joyeuse et réputée très accueillante, le voisin facteur qui animait des bals avec son accordéon, la famille « tuyaux de poêle» où violences intrinsèques alternaient avec grandes embrassades, l’algérien sympathique qui travaillait à l’usine avec mon père et sa femme qu’il appelait « Tutune », la famille d’en face dont les filles plus âgées me revendaient à chaque rentrée leurs livres de classe, l’institutrice du cours élémentaire au regard sévère qui, par sa présence deux maisons plus bas, nous incitait à nous tenir à carreau, la voisine qui nous vendait les œufs frais de la grand-mère… Tant de prétextes à cancans sur le trottoir quand deux mères se faisaient signe pour se signaler l’une à l’autre qu’elles étaient prêtes pour le papotage.
Ceux des HLM n’avaient pas la chance d’avoir comme nous un jardin et faisaient par beau temps sitting sur les marches de l’immeuble, jusqu’à ce que sonne l’heure de préparer le repas.
Quartier du Merle Blanc… Rue du Verger…
… et la fête du Merle Blanc, incontournable, où, le jour de celle des pères, défilaient chars décorés de fleurs en crépon et fanfares de tous ordres. Toute la rue était dehors. Certains avaient décoré leur balcon pour le concours des plus belles maisons. Ça applaudissait, ça riait, ça criait, avant de rejoindre la fête foraine derrière les immeubles, une fois que le char du Merle Blanc avait rempli son rôle de voiture balai derrière le char de la reine.
Quartier du Merle Blanc… Rue du Verger…
C’était mon quartier et c’était ma rue. Je n’y suis pas née… J’y ai vécu à plein temps de 4 ans à 18 ans, puis ce fut le pôle de rassemblement familial auprès de nos parents, jusqu’à ce qu’ils nous quittent pour un ailleurs définitif. J’aime à y passer de temps en temps, pour laisser tendrement émerger de ma mémoire des souvenirs que je croyais perdus… C’était chez moi, tout simplement.
De Jacqueline
La main dans celle de ma mère, j’irais au bout du monde…
Ce monde c’était la rue Laennec.
Chaque jour, nous partions à la découverte de cette rue de notre nouveau quartier.
J’avais trois ans.
Il me semblait être déjà très grande.
Tous mes sens étaient en éveil, attentive aux mots que ma mère échangeait avec les voisins, les passants de notre nouvelle rue.
Peu de voitures en ce temps -là. Le trottoir était large. Sous nos pas, les petits cailloux échappés du goudron crissaient… Quand nous nous arrêtions pour un petit bavardage, j’aimais les sentir rouler sous mes semelles, tout en observant les nouveaux visages rencontrés. J’aimais la lumière de leurs sourires, la lumière de l’air.
Puis, nous continuions toujours la main dans la main jusqu’au bout du monde…
Le monde à l’horizon, c’était une gigantesque glycine. Je ne connaissais pas encore son nom.
Par contre, sa couleur, du bleu -mauve, du violet me fascinait. En s’approchant, on sentait déjà son odeur suave et quand nous étions dessous c’était le sucré. L’épice, le délice…
Je serais restée toute la vie sous cet ombrage parfumé, enivrant.
Sous sa tonnelle, nous découvrions le bazar qu’elle abritait. Une vraie caverne d’Ali baba.
La dame qui tenait cet endroit magique était pour moi une fée. Elle se penchait vers moi et me souriait gentiment. J’étais arrivée au paradis !
C’était notre balade quotidienne toujours pleine de surprises à chaque saison.
Je retiens l’ambiance bienveillante, la joie de ma mère, le parfum dans l’air printanier.
Depuis ce temps, j’ai gardé au fond de mon cœur l’amour des balades. Des rencontres. Des bazars et surtout de la glycine.
De Christine
Le village de mon enfance, situé au cœur du Haut-Jura, abritait cinq cents âmes. Ma rue qui commençait de la place principale, comptait une dizaine de maisons, toutes en pierre de taille de granit jaune et tuiles en terre cuite rouge. Elle était légèrement en pente, ce qui était pratique l’hiver pour faire de la luge, et bordée de gros tilleuls odorants sous lesquels il faisait bon se mettre à l’ombre l’été. Dans l’ensemble, les voisins étaient affables, à part un vieux monsieur toujours un peu ronchon avec son chien qui aboyait sans arrêt. Je marchais toujours vite quand je devais passer devant chez lui, car il me faisait un peu peur. L’ancienne ferme que mes parents y avaient achetée, trônait au fond de la rue comme un château. Ils l’avaient restaurée à la sueur de leur front, et étaient très fiers du résultat de leur travail acharné. Elle était magnifique avec ses volets peints en vert bouteille et ses grandes fenêtres à meneaux. Ma mère, passionnée de fleurs, avait installé une balconnière à chacune d’elle, et elle les garnissait au fil des saisons : primevères et pensées multicolores au printemps, géraniums lierre rouges et roses associés à des pétunias blancs en été, bruyères et chrysanthèmes mordorés en automne et hellébores en hiver. C’était toujours une explosion de couleurs et d’odeurs. Et comme elle avait la main verte, elle réalisait tous les semis et boutures de ses plantations, et en distribuait à toute la rue. Nos plus proches voisins étaient un couple d’instituteurs retraités chez qui je passais le plus clair de mon temps libre. J’ai longtemps cru qu’ils étaient mes grands-parents, n’en ayant pas connu d’autres par ailleurs. Leur maison était plus petite, mais avait un balcon en sapin grenat au premier étage.
Tout le long de la maison, courait une glycine qui, le printemps venu, diffusait son parfum si délicat. J’adorais m’enivrer de cette odeur, qui reste pour moi encore aujourd’hui liée à l’insouciance de l’enfance. C’est ma madeleine de Proust. Ils m’avaient adoptée comme leur petite fille. Quand je passais devant leur porte en rentrant de l’école, je sentais la bonne odeur des pâtisseries que mémère Jeanne avait cuisinées : tartes aux pommes, madeleines, gaufres. Elle savait que je ne pourrais pas résister. Alors, par beau temps, je m’installais sur le balcon et je dévorais ses succulentes gourmandises. J’en ai encore le goût dans la bouche. C’était aussi mon poste d’observation.
De là, tout en lisant un des nombreux livres de leur bibliothèque, je pouvais guetter si ma copine Agnès arrivait pour jouer, repérer si le chat de la voisine d’en face se prélassait au soleil, pour aller le câliner, écouter les merles siffler et admirer le balai des hirondelles poursuivant les mouches et moustiques par temps orageux. Juste en face, notre autre voisine était veuve. Elle avait un grand jardin devant chez elle, où elle faisait pousser toutes sortes de légumes ainsi qu’un verger de pommiers, poiriers et pêchers. C’était agréable à contempler, un peu comme les jardins de Cheverny : le violet des aubergines, le vert des choux, des poireaux et des salades, le rouge des tomates et des fraises. J’aimais bien cueillir les fanes de carottes et de fenouil pour en faire des soupes pour mes poupées, ou leur fabriquer un lit avec les feuilles de betteraves rouge. Elle m’appelait souvent pour que je vienne l’aider à récolter tous ces beaux légumes, et je repartais à la maison avec mon petit panier plein. Le petit bol de fraises ou de framboises étaient souvent à moitié vide quand j’arrivais à la maison… A l’automne, je l’aidais à ramasser et cueillir les pommes rouges et jaunes, les poires du curé comme disait mon père, toutes dures et vertes mais qui seraient délicieuses pour Noël. Elle en distribuait à toute la rue pour que rien ne se perde comme elle disait. Les autres maisons abritaient des couples souvent jeunes qui étaient venus s’installer au grand air et au calme, mais obligés de faire trente kilomètres pour aller travailler dans la ville la plus proche. C’était donc un peu une rue dortoir qui s’animait le week-end avec des barbecues entre voisins. Les soirs d’été, on pouvait sentir la bonne odeur de saucisses grillées dans toute la rue et entendre des airs de musique ou de chanson quand ils avaient un peu bu.
Je garde un souvenir nostalgique de ma rue car c’était un autre temps et un autre monde. Je n’ai plus trop l’occasion, ni l’envie d’y retourner car tous ceux que j’ai aimés sont partis pour toujours. La moitié des maisons sont vides et à vendre, désertification des campagnes oblige et c’est bien dommage.
De Francis
Nostalgie
Je vais vous parler d’un temps que les moins de vingt ans …………………….……..
Plus de maisons, plus de rues à part la rue nationale, long ruban luisant et glissant à la moindre pluie, avec ses gros pavés de granit aux reflets rouge, bleu et gris, disjoints où poussent des herbes folles.
C’est ma première impression en arrivant dans notre village juste après la guerre. J’avais devant moi un champ de ruines. Comment se repérer dans ce désert de maisons rasées, sans verdure, avec des rues dont on devinait le tracé.
C’est dans ce monde, fait de trous de bombes, au milieu des gravats, de caves remplies d’eau que j’allais passer mes premières années de gamin.
Très vite je m’y suis fait. J’ai trouvé des camarades pour occuper mes temps libres, des jeudis et des dimanches. Nous allions toujours par monts et par vaux à la recherche de petits trésors dans les ruines des maisons, explorer des terrains vagues et fouiller dans des monceaux de ferrailles. Tous les arbres avaient disparu, à part quelques-uns le long de la nationale qui avaient survécu, pourquoi, comment, on ne se posait pas de question.
Il a fallu reprendre très vite le chemin de l’école et pour y aller, nous avions le choix entre deux trajets.
Le premier, un chemin de terre bordé d’un côté de haies d’aubépines, d’épines vinettes et bien d’autres essences qui n’avaient pas connu de taille depuis longtemps. Elles délimitaient une très grande prairie bien verte, avec de l’herbe bien grasse, et des taches jaunes à la saison des pissenlits. De l’autre côté, des jardins et quelques maisons qui avaient échappé aux bombardements.
Ce chemin avait de profondes ornières et des sillons de roues de chariots agricoles. Nous devions slalomer entre les flaques d’eau en automne et en hiver. Nous y faisions des glissades lorsqu’il avait bien gelé. En ce temps-là, pas d’automobiles ou d’engins du même genre, il était fréquenté par des attelages agricoles et nous devions faire attention aux chevaux qui nous gratifiaient de temps en temps d’un crottin bien odorant. A l’extrémité, un éclairage, un bec de gaz qui était ranimé le soir et mis en veille le matin. Nous arrivions enfin à l’école primaire après avoir croisé la rue de l’égalité, la rue du cimetière, l’ancienne mairie reconvertie en école primaire avec une cour avec ses gros pavés, ses grilles noires et pas un brin de verdure.
Le deuxième trajet, nous le faisions par la route nationale avec naturellement ses gros pavés sur lesquels on faisait des étincelles avec les clous de nos chaussures qui étaient censés éviter l’usure de nos semelles de bois..
Il nous menait au centre du village. Nous lui trouvions moins de charme. Une forge où l’hiver nous prenions une bouffée de chaleur, un maréchal-ferrant d’où on entendait les hennissements et les bruits du marteau à cent lieues à la ronde, une échoppe de cordonnier qui sentait le cuir, le caoutchouc et la colle, un bourrelier avec ses senteurs du métier, mais ce dont je me souviens le plus, c’est le bouquet d’odeurs chimiques de la droguerie. Toutes ces activités avaient retrouvé une place entre les ruines et donnaient vie à la rue principale bordée de platanes au tronc à l’écorce marbrée de taches blanches.
Ce chemin était plus long que le précédent. Nous l’empruntions lorsque l’on devait rapporter quelques courses, en particulier le pain, le paquet de tabac pour papa.
Aujourd’hui, tout cela a bien changé. Le chemin de terre a été goudronné, il est bordé de maisons particulières, un lotissement a vu le jour. La rue de l ‘égalité a été élargie, il y a des trottoirs et un parking. L’école primaire-mairie a été rasée, remplacée par une brasserie-restaurant. Le village a été reconstruit, plus de maréchal-ferrant, plus de cordonnier, plus de forge, la nationale est goudronnée, je n’y trouve plus rien de mon enfance.
J’habite bien loin du pays et je suis un peu nostalgique quand j’y pense.
De Nicole
Quelques rues, endroits de mon enfance
Dès mes six ans, ma mère et moi déménagions si souvent que je n’ai jamais eu d’ancrage.
Peu d’endroits qui me donnent une impression de « chez moi ». Et peu d’amitiés suivies.
Néanmoins, j’avais une grande liberté de vagabonder dans la ville.
Le matin, dans les rues passait une marchande de poires cuites au sirop de Liège et qui criait « des cûtes peûres madame », que des ménagères achetaient pour le petit-déjeuner.
Une douceur chaude dans les matins frileux.
Aux coins des rues, un chien tirait une charrette emplie de journaux du jour que vendait une vieille dame. L’expression « Pôves nos-ôtes èt les chins d’tchèrète », (pauvre de nous et des chiens de charrette), est encore employée de nos jours.
Dans l’étroite rue St-Rémy, un accordeur de piano, des bruits étranges et répétitifs et de beaux pianos en vitrine. Un peu plus loin, un cordonnier cousait des chaussures sur mesure, odeurs de cuir et colle mêlées, parfois si fortes que je me bouchais le nez. A l’étage, une dame descendait un panier d’osier avec une corde, elle recevait ses provisions de cette manière.
J’empruntais un chemin qui arrivait devant l’imposante cathédrale, ses cloches carillonnantes. Devant, une place fleurie au printemps de jacinthes à l’odeur entêtante, un parfum qui me donne une pointe de nostalgie.
La ville traversée par la Meuse et ses différents ponts. Un des plus anciens Le Pont des Arches aux statues sur les piliers, sur la tête desquelles on envoyait une pièce de monnaie en faisant un vœu. Un pont qui joint la rue aux cent costumes, boutiques de tailleurs pour homme et le quartier d’Outremeuse, quartier plus populaire, son église St Pholien.
Le quartier de naissance de Georges Simenon.
Le 15 août, c’est la fête de Marie avec un cortège, la sortie de Tchantchès qui représente l’ouvrier liégeois à l’esprit frondeur, son imposante femme, Nanesse sans oublier Charlemagne, géants en balade ce jour-là, dans les ruelles des statues de la Vierge, appelées potales.
Odeurs de bière, de frites, de mayonnaise et de pèkèt, genièvre.
Le bruit du tram qui martelait les pavés, la sonnerie des arrêts.
L’ancienne cours du Palais des Princes-Evêques, devenu palais de justice.
Je marchais, je marchais et regardais tout avec curiosité.
Mes meilleurs souvenirs sont odorants.
De Françoise B
Enfance.
La rue de mon enfance se termine dans l’eau. Comme presque toutes les rues de mon quartier. Mon quartier est une île ou plutôt deux reliées. Ce n’est pas vraiment mon quartier puisque nous habitons à la campagne. La rue de mon enfance, c’est la rue de mon école. Ma petite école. Le matin, il faut être à sept heures trente au bord de la route pour prendre le car du ramassage scolaire. Course éperdue de petites jambes hardies. On monte en escaladant les hautes marches du car, haletants, définitivement réveillés, riant de retrouver les copains.
Les arrêts avant – quatre enfants, cinq enfants, mon arrêt – trois enfants, les arrêts après – quatre enfants, trois enfants, cinq enfants, ainsi jusqu’à l’entrée de la ville. Et puis on arrive. Le lourd véhicule rouge des CARS ROBERT manœuvre lentement pour prendre sa place sur le grand parking bétonné en face de l’école. Interdiction de se lever avant l’arrêt complet. Un dernier coup de frein, la porte s’ouvre en accordéon, chuintant dans un gros soupir de bête. On quitte le car en criant. En criant, on s’éparpille.
Entre l’école et le car, il y a l’eau. Le canal qui sépare les deux iles. Il faut donc remonter le long du quai jusqu’au pont, traverser le pont puis descendre l’autre quai jusqu’à l’école presque tout au bout. Tous prennent la même direction. Le premier jour, les grands ont montré le chemin, maintenant chacun pour soi ou plutôt pour ses copains.
Quitter le parking, longer le quai, et surtout passer devant les toilettes publiques – puant monument de béton à deux entrées courbées que parfois on explore en cachette comme un lieu interdit, follement attrayant, médusés par les excréments putrides stagnant à l’air libre sur la cuvette des wc à la turque, ne comprenant rien aux graffitis obscènes gravés sur les murs luisant de saleté.
On arrive à la fontaine au bassin rond avec en son milieu une colonne à deux vasques ornées à sa base de quatre angelots de bronze. Tendre à chaque fois les mains sous le jet. L’eau remonte dans les manches. Fraicheur frissonnante. Quelques platanes sans âge donnent à l’endroit un air de place publique.
Plus loin, le parapet du quai est coupé par un escalier qui descend jusqu’à l’eau, suivi d’un trottoir d’accostage de dix mètres, terminé par un autre escalier qui remonte sur le quai. Et là, regarder émerveiller le fragile esquif noir amarré. Une gondole, une authentique gondole vénitienne à la figure de proue blanche ! On ne sait rien de Venise. Inventer. Incroyable embarcation d’un mystérieux prince oriental.
Et puis il y a le pont. Trois marches en pierre, on y est. Petit, étroit avec des rambardes en fer de part et d’autre. Sur la droite, à l’entrée, une drôle de petite taverne étrangement suspendue. Traverser. D’un côté l’eau, de l’autre l’eau. Descendre les trois marches et tourner à gauche, le long du canal.
On longe l’église de la Madeleine, long mur lépreux aux sept vitraux. Trop haut pour apercevoir le toit. Dans un renfoncement, un escalier de quatre marches, bordé d’une grille, montre une mystérieuse porte en bois clouté toujours fermée. Comme une boursoufflure de l’édifice, parallèle au quai, peut-être le presbytère. Collées à l’église, suivent une série de maisons colorées de niveaux différents. Deux, trois étages. Parfois tout là- haut, des terrasses sous les toits, débordantes de vert. Des jardins en altitude.
Les maisons s’écartent du quai pour former une place minuscule. Deux rues dans ce carrefour. Une part vers l’inconnu. L’autre, la rue de l’hospice fermée en impasse par l’hôpital. Incursions brèves et effrayées pour jouer les intrépides. Peu n’ont jamais guère dépassé l’entrée de la ruelle. Les adultes baissent la voix pour parler de cet endroit. On croit sentir dans l’air des odeurs de médicament, comme à la maison quand on est malade et que les parents chuchotent.
Sur la place, une boulangerie dans laquelle on pénètre en descendant une marche. La pénombre n’empêche pas de s’approcher de la vitrine aux bonbons. On connait le chemin par cœur. On montre des pièces de cinq centimes, dix centimes pour les plus chanceux. Tube de poudre de réglisse, coquillage Roudoudou, plaque de Zan, carambar, malabar, boule de meringue sèche recouverte de sucre à la noix de coco, ourson de guimauve enrobée de chocolat. Trésors éphémères recélés par des mains ardentes, dévorés par des bouches radieuses.
Pour clôturer la place, la maison au toit en chapeau de gendarme. Magistrale, s’avançant comme une figure de proue. Fer forgé au balcon suspendu, fenêtres en désordre trouant la façade, lourde porte cochère. Merveilleuse de décrépitude.
On continue sur le quai bordé de petites barques peintes dont on s’amuse à lire les noms – Manon, Fanny, Jeannette, Marie. L’odeur de la mer s’étale partout.
Enfin l’école. Large édifice de caractère en rez- de- chaussée, flanqué de part et d’autre d’une construction à étage. Tous les enfants se pressent là, devant l’escalier monumental, attendant que les portes s’ouvrent.
Devant l’école et jusqu’à la pointe de l’île, le quai n’est plus que berge naturelle avec des embarcations amarrées à des poteaux figés dans la vase. Tout au bord de l’eau, de grandes poutres surmontées de traverses en fer supportent d’immenses filets de pêche qui pendent comme des toiles d’araignée. Atelier de réparation navale. Enfants fureteurs interdits d’accès. On se penche sur l’eau et s’étonne de voir le fond. On aperçoit des hippocampes, fragiles, aériens, dansants. Parfois une étoile de mer orange, astre marin à cinq branches. S’il fait chaud, ce sont les méduses qui envahissent le canal. Gélatine irisée, translucide, mouvante.
Puis hors du monde pour toute une journée.
Le soir, quand la sonnerie l’autorise enfin, on dévale l’escalier de la libération. Il faut faire vite. Le car n’attend pas. On court. On court. On remonte le quai. Les filets de pêche, les petites barques, la maison au toit en chapeau de gendarme, la boulangerie, la rue de l’hospice, la place minuscule. On court. On court. Longue trainée d’enfants. Les maisons colorées, le presbytère, l’église de la Madeleine. La moitié du chemin. On court. On court. Les marches, le pont, la drôle de taverne, la gondole, les platanes, la fontaine, les toilettes publiques, le parking. Le car qui gronde. On monte le souffle court. On se laisse emporter.
De Claudine
Tranche de vie
Soixante-six kilomètres à parcourir pour un retour vers mes souvenirs. Quarante ans que j’ai quitté les lieux de mon enfance.
Pas de nom de rues dans ces hameaux des terres profondes de la Loire Atlantique, avec leurs prés et bois, champs de blés et de pommiers, étangs, fermes à vaches.
Pendant que je roule, je repense à toutes ces personnes qui ont jalonné ma vie, à tous ces lieux qui ont vu et entendu mes rires, mes pleurs, mes premiers émois, mes moments de doute et mes espoirs d’un ailleurs plus animé. Selon moi, rien n’a changé, je vais retrouver intacts les endroits que j’ai parcourus avec mes copines. Tout me revient en mémoire.
Je vibre dans l’attente de poser mes pas dans ceux d’autrefois. Le hameau constitué en majorité de longères a quelques maisons de style différents. Nous habitions, ma famille et moi, dans une de ces maisons d’un étage que certains appelaient pompeusement le « château » ; quel château ! décrépi, avec des sols défoncés dans certaines pièces, des murs salpêtrés, mais avec un immense grenier qui était notre domaine où nous pouvions accueillir nos camarades. Les grands n’y venaient quasiment jamais, dans ce quartier général, d’où s’échafaudaient les projets de toute sorte. La liberté sous condition en fait. Car il y avait des obligations dont la première était « avez-vous fait vos devoirs ? ». Pas de oui, sans avoir droit à une vérification.
Les souvenirs s’entrechoquent, en vrac. En face de notre maison, de l’autre côté d’un chemin pierreux, il y avait le potager – verger où poussaient aussi toutes sortes de fleurs, le tout planté par ma mère et des voisines. Ce qui donnait lieu à quelques querelles vite réglées devant un café. Mais moi, je n’en n’avais cure de leurs chicaneries. C’est dans cet immense espace clos que j’ai découvert le nom des fleurs, leur senteur, leur couleur, la façon de les planter, de les cueillir, de bouturer et ceci grâce à une « vieille » du hameau qui adorait transmettre son savoir.
Il me reste en mémoire l’odeur des roses anciennes et la vue de ces massifs d’hortensias aux couleurs diverses. Aujourd’hui encore, ce sont mes massifs préférés. A quelques mètres il y a un chêne majestueux qui a forcément pris de l’ampleur ; ce vénérable ancêtre nous offrait ces branches solides idéales pour nos balançoires, pour nos escalades à grands risques et pour la punition assurée. Mais aussi des glands que nous ramassions pour les porter aux cochons. Nous revenions avec un bidon en fer rempli de lait. A l’arrière de la maison, la grande prairie où les vaches à lait venaient paître et que nous osions poursuivre, non sans risques.
En bas du chemin, les carrières remplies d’eau, très dangereuses et formellement interdites par les parents. Ces carrières étaient d’immenses trous, faits par les engins qui pendant un temps en ont extrait la pierre pour la transformer en chaux. Le coin était génial, entouré de buissons qui avaient poussé au gré du temps. L’odeur des églantiers, des seringats, des pommiers sauvages restent présents. Quelle émotion en pensant à nos parties de pêche, qui nous occupaient pendant des heures, prétexte à nos baignades risquées, en culotte petit bateau. Pas de maillot de bains à l’époque, au moins pour nous, ceux des campagnes.
Plus bas encore, l’immense verger à pommes à cidre, là où nous croquions les fruits acides. Le père Jules regardait d’un œil bienveillant nos petites rapines ; je m’y vois à nouveau, sans le père Jules parti depuis bien longtemps.
Nous escaladions le grand portail en bois pour filer dans la petite forêt voisine, refuge des sangliers. Jouer à se faire peur, c’est amusant !
Que de moments heureux nous avons vécus, dans tous ces lieux, même si chacune de nous aspirait à un avenir bien différent. Notre horizon lointain se nommait Chateaubriant, à quinze kilomètres, c’est-à-dire, au bout du monde. Mais le vélo nous emmenait vers la liberté, le jupon au vent. Quelques garçons participaient à nos escapades et eux aussi imaginaient leur vie hors de ce hameau. Nous nous contentions de peu, mais quand même, dans nos esprits ce n’était pas ça la vraie vie. Chaque année, il y avait la fête au hameau qui réunissait autour des habitants, des gens du bourg qui arrivaient à moto ou en vélo pour danser au son de l’accordéon sous un chapiteau monté près du champ à pommes. Quelques voitures, pas beaucoup encore, nous impressionnaient, tant c’était nouveau !
Et la journée du porc : une autre fête, bien différente, mais malgré tout très festive. Cette journée où tous les gens du coin se réunissaient ; qu’ils soient ouvriers, fermiers, d’ici ou d’ailleurs. Ah ces journées ! où tous mettaient la main à l’ouvrage ; il ne fallait pas s’attarder car le « saigneur », qui venait faire l’exécution, allait de hameau en hameau pendant la période hivernale. Les enfants étaient réquisitionnés pour les tâches subalternes. De ceci, j’évite de me souvenir. Qui n’a pas senti l’odeur du sang, entendu le cri du goret pendu par les pieds à une échelle attendant la mort, ne sait pas. Il parait que les règles ont changé. Mais pas les exécutions mieux encadrées, dit-on.
En été, c’était la fête des moissons, un événement majeur. L’odeur du foin fraîchement mis en bottes, la fumée des feux allumés pour griller le porc tué l’hiver ; toutes ces senteurs mêlées me sautent aux sens. Je revois les grandes tablées et nos jeux en dehors des occupations des adultes, après que nous ayons terminé nos tâches, rempli les bouteilles de ce cidre maison qui coulait à flot des barriques mis en perse.
Je file, en respectant, si possible la vitesse. Saint Julien de Vouvantes ; c’est bientôt l’arrivée vers le gîte choisi. Tout à coup, je réalise qu’il y a quelque chose qui cloche. J’arrive à la hauteur des fours à chaux. Trop loin de mon point de chute ; mais que s’est-il passé ?
Mon hameau, comment n’ai-je pas vu mon hameau ? La Rousselière ! Je fais marche arrière. Je roule lentement. Stupeur ! il n’y a plus rien. Ce n’est pas possible, tous mes rêves, mes souvenirs ont été détruits. Les maisons, ma maison et d’autres encore, envolées, détruites. Plus de « château », plus de potager, même celui de mon grand-père est devenu une friche. Plus de vergers. Plus de petits bois. Plus de grand chêne. Rien. Tout est anéanti, mon enfance, mon adolescence sont passés sous les roues des monstres de la société des fours à chaux.
Un dimanche, jour sans risques de dynamitage, j’ai fait le tour des gigantesques excavations, les larmes aux yeux. C’est dur de ne pas retrouver son enfance, même si elle a été mise de côté pour réaliser ses rêves.
Quant aux copines de classe, un presqu’échec. Nos vies avaient été trop différentes pendant toutes ces années, pour permettre de renouer. Certaines avaient choisi la quiétude des lieux si connus.
L’église de style roman, qui domine de sa hauteur le centre du village, haute, vaste, lumineuse, à fort belle allure, est toujours là, mais défigurée par le clocher-porche ultra moderne construit à la fin du 20ème siècle. Lieu symbolique qui en a vu des événements familiaux, dont certains nous ont conduit vers le cimetière. Lui aussi a subi un lifting, mais à son avantage. Je cherche, ici, là, dans toutes les allées. Rien, encore une fois, rien, plus de stèles pour se recueillir. L’extension et le remodelage a éjecté tous les anciens, tout comme une partie de mon école, et la disparition des commerces d’antan. Lieux de tant de souvenirs, effacés, dilués, détruits. Seule ma mémoire les garde précieusement désormais.
De Marie-Josée
La rue de mon enfance
La rue de mon enfance avait un nom bien étrange,
Difficile de trouver son égal, elle s’appelait ‘’Le manche de la poêle’’
Les canards s’y dandinaient, ignorant le danger qu’un tel nom représentait.
Heureusement pour eux, les ondines veillaient sur eux.
La rue de mon enfance était un lieu d’échange.
Elle donnait sur la rivière, lieu de rendez-vous des lavandières.
Elles y faisaient irruption, armées de bassines, de brosses et de savon.
Elles frottaient, rinçaient, se plaignaient et riaient.
Dans la rue de mon enfance, les conflits se réglaient sans violence.
Tout le monde se connaissait, joies et peines étaient partagées.
En été, on alignait les chaises le soir, on refaisait le monde sur le trottoir.
Le visage épanoui, on se quittait tard dans la nuit.
Dans la rue de mon enfance, pas de caméras de surveillance.
Nos lieux de prédilections étaient les écarts entre les maisons.
Ils étaient notre cachette pour fumer les premières cigarettes.
On s’y croyait à l’abri pour braver les interdits.
La rue de mon enfance changeait pendant les vendanges.
Des chariots tirés par des chevaux acheminaient les raisins aux tonneaux.
Les effluves des caves bien remplies envahissaient les narines et les esprits.
Ils laissaient présager que le vin nouveau coulerait bientôt.
Dans la rue de mon enfance, le maître-mot était confiance.
Parties de ballon et de billes, sur l’air du ‘’ Palais royal’’ sautaient les filles.
L’avenir ne nous faisait pas peur, on avait foi dans des jours meilleurs.
La roue de la vie tournait, convaincus que la chance serait à nos côtés.
La rue de mon enfance n’a pas échappé au monde qui change.
Elle a été rebaptisée, les voitures ont remplacé les chaises alignées.
Portes et volets fermés, les soirées se passent devant la télé.
Réseaux sociaux, téléphone et ordinateur font maintenant le bonheur.
Dans la rue de mon enfance, les chats rôdent avec nonchalance.
Les canards s’ébattent dans la rivière, un coq voisin, s’égosille et fait le fier.
Les maisons n’ont plus le même aspect, elles ont été modernisées.
Même si tout n’est pas parfait, il fait toujours bon y habiter.
De Françoise V (proposition d’écriture N° 159)
Mes enfants Micha et Nadia n’en revenaient pas :
« Deux billets de mille francs ! Tu as fait de la monnaie avec tout cet argent ? » s’étonna Nadia.
Puis, un employé de la maison vint me chercher avec le Général.
-Attendez, Georges, s’il vous plaît, venez approchez, me dit le Général. Je vous retiens quelques minutes. Je vous demanderai de bien vouloir sortir vos filles un peu plus tard, c’est important que je vous vois.
Le Général tira la porte derrière lui en m’attirant dans son bureau.
– Je vous ai entendu parler à Micha et Nadia. Vous n’avez pas à divulguer la mission secrète dont je vous ai chargé. Personne ne doit savoir hormis vous et moi. Mon conseiller diplomatique de Moscou a confiance en moi. Je suis chargé d’acheter de l’or en toute discrétion. Je vous demanderai en plus de stocker ce trésor dans le coffre que je vous ai confié. Tenez, voici la clé et le code. Personne ne doit savoir, surtout pas vos filles. Cet or servira à faire libérer le Commandant Dupognon de la 1ère cavalerie. Il est sous les verrous à Zurich. J’ai, pour mission, un compromis : sa libération et cette transaction. Le consulat est prévenu, mais toujours en toute discrétion. Secret d’État.
Et pendant qu’il me parlait, les filles riaient entre elles et chahutaient à côté de la balustrade.
Tout à coup, Nadia loupa la marche de l’escalier derrière notre bureau. Elle dérapa et descendit en roulant comme un pantin. Micha m’a raconté l’horreur. Sa tête frappa la dernière marche. Micha se précipita en criant : Papa ! Les cris de Nadia étaient étouffés, ceux de Micha stridents, angoissés. Puis, silence. Plus un bruit. Elle ne bougeait plus, du sang s’écoula de sa bouche. Ses yeux regardaient le plafond, fixes, sans vie.
De Roselyne
La rue Notre-Dame à Laleu
La rue de mon enfance est une rue qui part de la Place des Halles, d’une longueur d’environ 800 mètres. Elle descend en pente très douce jusqu’aux dernières maisons dont celle de mes parents, acquise dans la fin des années 50. Ces bâtiments appartenaient Aux Sœurs de La Sagesse, dans lesquels se trouvaient leur lieu d’habitation et une école. Autant dire, que nous avions de l’espace. Après la demeure parentale ce sont les champs. Pour ma part, j’ai toujours vécu dans les lieux jusqu’à mon envol.
En partant de La Place des Halles, les maisons sont sagement alignées, sauf à un seul endroit. En effet, en arrivant, environ deux cents mètres avant l’intersection, rue A. Forestier et rue de l’Eglise, il y a un décrochement qui se porte sur deux maisons. Pourquoi ? Je ne saurai donner d’explication.
En descendant la rue, sur le côté droit, les maisons sont un peu plus cossues. L’une d’entre elle, dont je me souviens particulièrement à un grand portail qui s’ouvre largement sur une cour. La maison qui se trouve très en retrait de la route offre une façade percée de plusieurs fenêtres en rez-de-chaussée, ainsi qu’à l’étage. Celle-ci n’est pas étrangère à la fratrie, les propriétaires sont des amis des parents. Nous rejoignons cette bâtisse par la rue A. Forestier où nous arrivions par l’immense jardin et parc attenants à la maison. Il y a un grand bassin, dans lequel, l’été les grenouilles s’époumonent jusque tard dans la nuit. Dans ce jardin, des cerisiers fabuleux offrent aux gourmands une belle corbeille de fruits.
Mais revenons à la rue, vers le milieu, une maison fermée par une grille en fer forgé laisse apparaitre le jardin fleuri avec goût ; il offre aux passants un spectacle coloré et apaisant. Dans le décrochement, une autre maison entretenue avec soin, c’est celle de deux sœurs, dont l’une est libraire. S’en suit une autre dans laquelle toujours des sons de voix s’échappent, les enfants se chamaillent, les parents crient. L’été, tout ce joli petit monde vit dans la rue. Il faut dire qu’un vaste terrain non bâti jouxte cette maison, ce qui laisse libre cours aux ébats des mômes.
Sur ce terrain, un long bâtiment sert à une entreprise de menuiserie. Quelques années plus tard, il sera transformé en cinéma de quartier. Puis la maison de mes parents dont j’ai parlé. Après, ce sont les champs où les vaches pâturent, tranquillement. Elles appartiennent au fermier qui se trouve en face de chez mes parents. Nous allons nous ravitailler en lait tous les soirs. Je me souviens, que lors du Premier de l’An, nous recevions des chocolats, un peu blanchis, mais nous, les gosses, nous étions ravis de croquer dans ceux-ci.
Sur le côté gauche de la rue, toujours en descendant, les maisons sont rangées sagement en ligne. Rien ne déborde. Les façades, de mémoire peintes de couleur plutôt claire. Tout est propre.
Les odeurs de cuisine, surtout aux beaux jours, embaument l’espace. Les fenêtres sont ouvertes, l’activité est perceptible dans chaque chaumière. L’œil peut apercevoir rapidement l’intérieur de ce lieu, où la famille se rassemble pour déguster le plat mitonné par la maîtresse de maison. L’on peut percevoir le bruit de la casserole qui chante sur le feu, le sifflement de la cocotte-minute entrée dans les foyers et qui rend mille services à la ménagère. Le cri de « à table » retentit entre les murs, on peut presque entendre la dégringolade des enfants dans l’escalier. Lorsque ceux-ci sont dehors, ils s’éparpillent comme une volée de moineaux.
Peu de véhicules circulent, le moyen de locomotion est plutôt le vélo ou la mobylette. Par contre, il y a les marchands ambulants tels que le boulanger, le boucher. J’ai même connu, tous les vendredis (à la saison) la marchande de sardines fraîches qui descend la rue avec sa carriole en claironnant «sans- sel, sans sel, mesdames ». Deux fois par an, le rémouleur, lui aussi passe avec sa meule roulante, chacun lui amène et qui des couteaux, et qui des ciseaux pour que ceux-ci soient remis à neuf. A l’automne, grand spectacle sur la petite place qui se trouve juste à côté de la rue, le distillateur installe son alambic. Les cuivres rutilent, les enfants sont émerveillés par ce bel ensemble. Puis la magie commence, les odeurs, les vapeurs de la distillation se répandent dans l’air, l’environnement sent bon la pomme. Les effluves circulent dans l’atmosphère, c’est jour de fête sur la place. Sur cette place, les vestiges de l’ancienne église Saint Pierre bombardée en 1940. Bien sûr, tous les rejetons des familles sont agglutinés autour de l’alambic, en espérant un petit canard d’alcool sur un morceau de sucre. C’est juste bon.
Autre chose qui me reste en mémoire, le marchand de peaux de lapins, il crie « peaux de lapins, peaux de lapins, peaux ». Dans chaque foyer, le poulailler et le clapier sont de rigueur. Rien n’est perdu, les peaux sont achetées, trois sous probablement aux citoyens, celles-ci sont recyclées, déjà !
Le marchand de pains de glace aussi a une drôle de façon de faire transiter les pains dans les foyers. Il fait glisser ceux-ci sur le bitume. Toutes les familles ne possèdent pas de réfrigérateur, tant apprécié de nos jours. Evidemment, le pain a perdu quelques centimètres et « le glacier », avec un crochet, agrippe le pain afin de le poser dans le tiroir du meuble qui sert à conserver les aliments au froid.
J’ai volontairement parlé au présent, en effet, de nos jours, la physionomie générale de la rue est la même. Seul, le terrain vague a été construit et les champs eux n’existent plus. Une zone industrielle s’est développée jusque pratiquement au pont de l’Ile de Ré. Ce sont des souvenirs bien ancrés dans ma mémoire ; ils ont parsemé mon enfance. Parfois, il m’arrive de pousser jusqu’à ce lieu de vie où j’ai passé 24 ans de ma vie, mais j’y vais sans nostalgie. C’était un temps heureux.
(photo envoyée par Roselyne)

D’Elie
Il y a très longtemps, et plus précisément en 1973, je passais une bonne partie de mon temps d’enfance à faire la conquête des fruits sauvages, à l’exploration des espèces végétales irriguées par les rivières et les ravins.
Animé par la passion de retrouver les rues des champs qui font la vie mouvementée des collectivités Zoukounou, Zogbanou, Sinmènou et des Ayinon dans la vallée de l’Arrondissement de Domè à l’Est de la commune de Zogbodomè.
Gnitin est le village qui m’a vu naître en 1961, le dix-huitième jour du neuvième mois. Ce petit village compte une population de 800 habitants environ. Plusieurs ruelles débouchent sur la maison du peuple, et les résidences rustiques réservées à l’habitation de la population. Ces ruelles dans l’ensemble forment des ramifications qui débouchent au marigot, et sur les plantations de maïs, de manioc, d’arachides et de papayers en pleine maturation.
Et par endroits, s’observent des arbres géants, tels que des baobabs, des irokos et fromagers qui ont déjà séjourné vingt, trente, voire cent ans sur la terre. Et sur certains arbres sont perchés des perroquets qui chantent des regains de leurs belles mélodies. Tombés sous les coups d’une admiration inédite, Bonou, Kossi et moi, nous mettions à imiter ces oiseaux puis à réinventer, à notre tour, une chorale improvisée. En poursuivant, notre marche, nous avons le plaisir de nourrir notre curiosité à l’exploration des espèces végétales ou animales. Mon beau village, la terre sur laquelle j’ai été conçu, constitue un pôle d’attraction à cause de la richesse de ses champs, et celle des rivières arborées donnant l’épanouissement et la vie à sa population.
Alors que nous avons pris par la ruelle menant à la grande palmeraie de mon grand-père, nous avons fait la rencontre des paysans qui revenaient de leurs activités champêtres. Le soleil dardait ses rayons de plomb et faisait ruisseler les corps de sueur abondante. La fatigue et la faim étaient là, exerçant leurs lois sur les agriculteurs dont la renommée n’était plus à démontrer dans notre village.
J’entendis Avogbè, mon oncle, qui avait un tubercule de manioc cru qu’il croquait, dire :
-Mes frères, attendons un peu et asseyons-nous sous l’ombrage rafraîchissant de ces arbres qui longent le bord la rivière, Hlin.
A ses mots, tous, au nombre de dix, s’assirent pour prendre le bain de fraîcheur naturelle que transportait l’air et qui redonnait force et vitalité à nos cellules. Ayant vu parmi ces parents du village, nous nous sommes mis un peu à l’écart pour longer les abords du fleuve Hlin. Kossi, Bonou et moi avions commencé par explorer les feuillages et avions vu quelques oiseaux postés sur des palmiers. Il faut remarquer que des bandes de tisserins gendarmes avaient déchiqueté les feuillages de certains palmiers pour en faire leurs nids au loin, sur des arbres ou dans les endroits les plus cachés des broussailles.
Bonou après avoir examiné l’activité des tisserins a dit :
-Regardez l’état dans lequel ils ont ses palmiers. Ils ont détruit ces palmiers pour en construire des nids qui ne seront d’aucune utilité à l’homme.
Kossi fit un quart de tour de regard et dit :
-Il est vrai que ces tisserins ont mis à nu les palmiers mais reconnaissez que ce sont de grands bâtisseurs. Les tisserins possèdent les instincts d’ingénierie qui doivent nous inspirer à la culture de l’esprit scientifique.
Les paroles de Kossi étaient une lumière à nos consciences. Je répliquai pour confirmer les propos de Kossi :
-Mon ami Kossi est bien sous l’inspiration qui nous éclaire cet après-midi. Nos promenades sont pour nous des moments d’éducation pour le présent et l’avenir. Les temps de l’enfance doivent être pour nous de belles opportunités à exploiter. Une enfance bien gérée est un véritable bonheur pour la vie.
C’est un vrai bonheur de vous retrouver toutes et tous pour ce rendez-vous hebdomadaire qu’est l’atelier d’écriture du blogLA PLUME DE LAURENCE.
Nous avons un souvenir bien précis de la rue de notre enfance. Moi, j’habitais dans une rue portant un nom célèbre, Jean Jaurès. Je ne savais pas, gamine, de qui il s’agissait. Nous habitions au 190, au bout de cette rue, assez longue par ailleurs, face à l’école maternelle et aux écoles primaires.Jusqu’à l’âge de 8 ans, les garçons et les filles, nous étions séparés dans des écoles différentes. Dans ma rue, il y avait des commerces: le coiffeur, le poissonnier, une petite épicerie de quartier, une teinturerie et un autre commerce dont j’ai oublié la fonction. A ce temps-là, on pouvait circuler à vélo, nous les gamins, sans que les parents ne s’inquiètent. On était tranquilles: ils ne nous envoyaient pas de message toutes les heures! On vivait sous une certaine forme d’insouciance et de liberté, qu’on ne retrouve plus de nos jours. Je vivais dans une ville de banlieue, dans le nord de la région parisienne, une ville qui s’offrait encore des airs de campagne. Comme our vous, tout cela a disparu, mais la maison de mes parents résiste toujours, face à l’école…souvenirs intemporels!Je vous souhaite un beau weekend du 1er mai!Je vous souhaite tout le bonheur possible…Je vous donnez rendez-vous la semaine prochaine pour d’autres aventures d’écriture…
Créativement vôtre,
Laurence Smits, LA PLUME DE LAURENCE